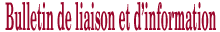Le processus appelé « une Turquie sans terreur » par les autorités et « processus de paix » par le parti pro-kurde DEM a franchi une étape importante avec la constitution d'une commission parlementaire spéciale, chargée d'élaborer des propositions pour offrir un cadre légal.
Elle est composée de 48 députés dont 25 de la coalition gouvernementale (l'AKP du président Erdogan et son allié d'extrême droite MHP), dix du Parti républicain du Peuple (CHP, centre-gauche), quatre du parti pro-kurde DEM et neuf issus d'autres partis de l'opposition parlementaire.
Cette commission transpartisane doit « proposer et préparer des réglementations juridiques qui rendront la paix permanente ainsi que le désarmement complet », a déclaré le président du Parlement en ouverture de ses travaux le 5 août, célébrant « le début d'une ère nouvelle ».
Selon Numan Kurtulmuş, qui présidera les travaux, la commission entendra « tous les segments de la société » : intellectuels, universitaires, juristes et représentants de la société civile. « Elle ne va pas seulement rédiger des rapports, mais va également suivre le processus du désarmement au nom du peuple », a-t-il ajouté.
Selon lui, « la commission réunie ici (...) est une délégation historique, qui témoigne du courage de reconstruire notre avenir et de la volonté de renforcer l'intégration sociale ».
Le processus de paix est « une question de survie qui concerne l’avenir commun des citoyens de tous horizons, tant turcs que kurdes », a affirmé M. Kurtulmuş.
La création de cette commission était une demande du chef emprisonné du PKK Abdullah Öcalan, qui avait appelé en février dernier à la dissolution du PKK et à la fin de la lutte armée.
Dans son esprit, cette commission doit proposer un cadre légal pour le désarmement du PKK et l’intégration des milliers de ses combattants. Elle devra également proposer des réformes démocratiques pour garantir la reconnaissance de l'identité kurde et la libre expression de la langue et de la culture kurdes.
Répondant à l'appel de son fondateur, le PKK avait réuni en mai dernier un congrès qui a décidé de son auto-dissolution. Dans un geste symbolique médiatisé, une trentaine de combattants ont, lors d'une cérémonie télévisée près de Suleimanieh, déposé dans une vasque et brûlé leurs armes. Mais les dirigeants de l'organisation ont aussi fait savoir qu'il n’y aura pas de désarmement complet sans garanties légales.
L’élaboration de ces garanties fait partie de la mission prioritaire de cette commission dont les travaux pourraient se poursuivre au moins jusqu’à l’hiver, selon son président.
Jusqu’ici, le bloc au pouvoir du président Erdoğan a cédé peu de terrain. De manière révélatrice, le président du parlement, Numan Kurtulmuş, a averti que « ce n’est pas un processus de négociation », signalant qu’Ankara voit la commission non comme un forum pour traiter des revendications politiques kurdes, mais simplement pour gérer la reddition du PKK. De telles attitudes soulignent les craintes kurdes que l’État cherche la capitulation, non la réconciliation. La rhétorique d’extrême droite demeure inchangée : alors même que les Kurdes tentent un engagement de bonne foi, le ministre turc des Affaires étrangères a réitéré en août que les YPG (Unités de protection du peuple) kurdes de Syrie (qu’Ankara assimile au PKK) devaient montrer des « mesures de confiance » ou être traités comme des terroristes. Cette posture anti-kurde dans la politique régionale trahit la « phobie kurde » persistante d’Ankara, disent les critiques, et augure mal d’une paix authentique.
Rien n’a mieux illustré la mauvaise foi d’Ankara que le traitement réservé aux « Mères de la Paix », un groupe de mères kurdes ayant perdu des enfants dans le conflit et plaidant pour la paix. Le 20 août, ces femmes ont été invitées à s’adresser à la commission parlementaire transpartisane, pour se voir interdire de parler en kurde. Le compte rendu officiel notait banalement « l’oratrice a utilisé une langue autre que le turc », tandis que la président de la commission coupait la parole à quiconque ne s’exprimant pas en turc. Une mère, Nezahat Teke, a supplié qu’elle pouvait exprimer sa douleur et ses espoirs mieux dans sa langue maternelle, « Je suis née d’une mère kurde, élevée avec des berceuses kurdes, souffrant en kurde, pleurant en kurde », mais on lui a refusé cette possibilité.
De même, le gouvernement s’est abstenu de faire le moindre geste en faveur des prisonniers politiques kurdes, dont l’ancien député et candidat à la présidence de la République Selahattin Demirtaş, embastillé depuis dix ans pour délit d’opinion.
Les maires kurdes destitués et remplacés par des administrateurs judiciaires nommés par le ministre de l’Intérieur ne sont toujours pas rétablis dans leurs fonctions.
Le pouvoir utilise cette période de « dialogue » avec le parti pro-kurde DEM pour attaquer la principale formation de l'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), dont les maires élus sont poursuivis et arrêtés les uns après les autres sous le prétexte de « lutte contre la corruption » dans un pays mis en coupe réglée par les oligarques proches du régime, en toute impunité. Les figures de proue de ce parti, le maire d’Istanbul Ekrem İmamoğlu et le président Özgür Özel, sont poursuivis sous des prétextes variés et souvent invraisemblables par une justice turque politisée et aux ordres, chargée d’éliminer en amont les candidats potentiels de l’opposition pour les prochaines élections présidentielles, où le président Erdoğan envisage de se présenter pour un nouveau mandat.
Sur le plan extérieur, la Turquie se pose de plus en plus en parrain du Hamas, dont les dirigeants en exil sont régulièrement reçus comme « combattants de la résistance » à Ankara.
Entre Israël et la Turquie, la guerre des mots fait rage et l’éventualité qu’elle puisse finir par se transformer en un conflit armé en Syrie est désormais ouvertement évoquée.
Le 14 août, la Turquie a signé un mémorandum de coopération militaire avec Damas qui promet des systèmes d’armes, de la formation et un soutien logistique à l’armée syrienne. Le geste a été largement interprété comme un signal qu’Ankara était prêt non seulement à faire pression diplomatiquement sur les Kurdes, mais aussi à renforcer militairement Damas pour démanteler l’autonomie kurde.
Fin juillet, la Syrie, la France et les États-Unis avaient annoncé un accord pour organiser à Paris, « dans les plus brefs délais », des discussions sur la mise en œuvre de l'accord signé le 10 mars entre le président par intérim al-Charaa et le général Mazlum Abdi, chef des Forces démocratiques syriennes (FDS).
Les deux cosignataires de cet accord prévoyant l'intégration des FDS et des institutions de l'administration du Nord-Est de la Syrie dirigées par les Kurdes étaient invités par le président Macron à Paris pour discuter des modalités et du calendrier de la mise en œuvre de cet accord afin de consolider le nouveau régime syrien tout en prenant en compte les revendications kurdes de décentralisation et de pluralisme.
Une conférence tenue dans la zone sous contrôle kurde et en présence du général Abdi avait réuni quelque 400 délégués représentant les Kurdes et les minorités ethnoreligieuses de Syrie. Les délégués avaient formulé une série de demandes pour l'avenir de la Syrie, dont une constitution démocratique garantissant le pluralisme politique, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme et les droits des minorités ethnoreligieuses dans le cadre d'un régime décentralisé.
Les Alaouites et les Druzes, qui ont subi des massacres de la part des milices pro-gouvernementales et qui sont très inquiets des orientations islamistes, centralisatrices et autoritaires du nouveau régime, se sont associés aux Kurdes pour la défense de cette alternative démocratique proposée par la conférence de Hassaké : une alternative rejetée par le régime de Damas et ses parrains turcs.
L'envoyé spécial américain pour la Syrie, l'ambassadeur Tom Barack, qui avait déjà exercé de fortes pressions sur la direction kurde pour la signature de l'accord-cadre du 10 mars, semble avoir réalisé la difficulté de parvenir à un compromis, tant la méfiance kurde est grande au vu du sort infligé par le régime aux Alaouites et aux Druzes.
D'où l'idée d'associer la France, qui entretient d'excellentes relations avec les dirigeants kurdes de Syrie et d'Irak. Lors de sa visite à Erbil, en avril dernier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait rencontré le général Mazlum Abdi pour s'informer directement de la situation des Kurdes syriens, « des frères d'armes des forces françaises », pour leur exprimer « le soutien de la France, qui ne les abandonnera jamais ».
C’est dire combien les dirigeants kurdes syriens comptaient sur la médiation de la diplomatie française pour contrebalancer l'influence néfaste et anti-kurde de la Turquie sur le régime islamiste de Damas. Celui-ci a annoncé le 9 août qu’il ne participera pas aux pourparlers prévus à Paris sur l’intégration de l’administration kurde semi-autonome de Syrie au sein des institutions de l'État central, exigeant que toute négociation future se tienne à Damas (AFP, 9 août).
Le gouvernement syrien « invite les médiateurs internationaux à transférer toutes les négociations à Damas, seul lieu légitime et national pour un dialogue entre Syriens », a ajouté un responsable syrien cité par l'AFP. Selon lui, le gouvernement de Damas ne souhaite pas l’internationalisation des affaires syriennes et refuse toute ingérence étrangère. Sauf, assurément, celle de la Turquie, dont le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a effectué, la veille de cette déclaration bravache, une visite non prévue à Damas pour « conseiller » au président syrien al-Charaa de ne pas se rendre à Paris et d’éviter toute internationalisation de la question kurde en Syrie.
Le 12 août, à la demande du gouvernement syrien, une rencontre à Damas a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, et la cheffe de la diplomatie kurde syrienne, Ilham Ahmed.
Leurs discussions ont porté « sur la recherche d’une formule adaptée à la décentralisation », sans calendrier précis pour sa mise en œuvre « selon une source kurde citée par l'AFP » (12 août). Les échanges visaient, selon la même source, à relancer « la poursuite du processus de négociation via des commissions syro-kurdes sous supervision internationale ». Les deux parties sont convenues qu’il n’y a pas de solution militaire.
Le lendemain, le 13 août, le ministre turc des Affaires étrangères était reçu à Ankara par son homologue syrien. Au cours de la conférence de presse commune, le ministre turc s’en est pris aux combattants kurdes du YPG (Unités de protection du peuple), qui « ne s’intègrent pas dans le système et gâchent le jeu en Syrie ».
« Des membres de l’organisation, originaires de Turquie, d’Irak, d’Iran et d’Europe, n’ont pas quitté la Syrie (...). Nous n’avons constaté en Syrie aucune évolution indiquant que l’organisation a éliminé la menace d’une action armée », a-t-il ajouté, avant de mettre en garde : « La Turquie ne cherche ni l’occupation ni la domination de la région. Mais dans un contexte où ses exigences sécuritaires restent insatisfaites, nous n’avons aucune chance de rester tranquilles. Nous le disons ouvertement. »
Le nouveau régime syrien se prépare à mettre en place un « parlement transitoire ».
En juin, un décret présidentiel a institué une commission électorale de dix membres chargés de superviser la formation de comités locaux appelés à désigner 140 personnes, du 15 au 20 septembre, pour siéger dans ce "parlement" de 210 membres.
Les 70 autres « députés » doivent être désignés directement par le président par intérim.
Le processus sera « reporté » dans les provinces de Raqqa et Hassaké sous contrôle kurde et dans celle de Soueida, à majorité druze dans le sud du pays, un report dû aux « défis sécuritaires dans ces provinces ».
Des sièges seront « réservés » pour les trois provinces afin qu’ils soient pourvus ultérieurement, a déclaré à l’AFP (23 août) un membre de la commission électorale.
Selon la déclaration constitutionnelle, le Parlement disposera d’un mandat renouvelable de deux ans et demi. Il exercera les fonctions législatives jusqu’à l’adoption d’une constitution permanente et la tenue de nouvelles élections.
Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes, ont continué à combattre les cellules restantes de l’EI (Daech) tout au long du mois d’août 2025. Les combats ont été particulièrement actifs dans la province de Deir ez-Zor, où persistent des cellules dormantes de Daech. À la mi-août, le Conseil militaire de Deir ez-Zor des FDS a conclu une opération de ratissage autour de Gharanij, capturant plusieurs militants de Daech. Malgré ces avancées, les attaques de Daech ont infligé des pertes aux combattants des FDS et aux habitants. Le 6 août, deux combattants des FDS ont été tués lorsque Daech a tendu une embuscade à une patrouille dans l’est de Deir ez-Zor. Plus tard dans le mois, des hommes armés de Daech ont assassiné un directeur d’école local.
Les forces de la coalition internationales ont également porté des coups à Daech durant cette période. Le 20 août, un raid de la coalition dirigée par les États-Unis dans le nord-ouest de la Syrie a visé un haut responsable de Daech, capturant un commandant djihadiste irakien lors d’un assaut héliporté avant l’aube. Il s’agissait du deuxième raid majeur américain depuis que le nouveau gouvernement intérimaire de Syrie a pris le pouvoir, signalant l’engagement soutenu de la coalition à traquer l’EI. Notamment, des responsables du Commandement central américain avertissent que Daech « continue de représenter une menace » au niveau régional, et que les djihadistes ont déplacé leur attention vers la déstabilisation des zones tenues par les Kurdes.
Enfin, le 28 août environ 850 ressortissants irakiens affiliés au Daech ou des membres de leurs familles détenus dans le camp de réfugiés d'Al-Hol au Rojava, ont été rapatriés en Irak. Depuis le début de l’année quelque 11.000 irakiens ont ainsi été rapatriés et les quelques milliers d’autres détenus dans les camps gérés par les forces kurdes devraient été rapatriés avant la fin de l’année.
Fief de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) et capitale culturelle du Kurdistan irakien, la ville de Souleimanieh a été le théâtre d'une série de troubles violents en août.
Le 13 août, la police a arrêté le chef du principal parti de l'opposition parlementaire Nouvelle Génération, Shaswar Abdulwahid.
Cet homme d'affaires, propriétaire entre autres d'une chaîne de télévision kurde, a été arrêté à son domicile dans le cadre d'une affaire judiciaire.
Une source judiciaire a expliqué à l'AFP (13 août) que cette arrestation faisait suite à une condamnation par contumace à six mois de prison pour ne pas s'être présenté aux audiences d'un procès après une plainte pour « diffamation » déposée par une ex-parlementaire. Il serait également redevable d'une ardoise de plus de 80 millions de dollars au Trésor public.
Cet opposant populiste, fustigeant sur sa chaîne corruption, pauvreté et chômage sévissant au Kurdistan, refuserait de payer des impôts dus par ses sociétés, estimant que sa position de chef de parti et patron d'une chaîne de télévision devrait lui assurer une certaine immunité, voire interdire toute action judiciaire le visant, pouvant être susceptible d'être qualifiée de persécution politique. Son parti, Nouvelle Génération, avait lors des élections d'octobre 2024 obtenu 15 sièges au Parlement du Kurdistan, qui en compte 100. Ses partisans sont descendus dans la rue pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une « persécution politique ». La justice, saisie de l'affaire, devrait organiser son procès dans les semaines à venir.
Le 22 août, c’est l’ex-coprésident de l’UPK évincé Lahur Talabani, qui a été arrêté lors d’une opération violente. Évincé de la direction de l’UPK par son cousin Bafel Talabani, fils aîné de l’ancien président de la République irakienne et fondateur de l’UPK, Jalal Talabani, il avait créé son propre parti, le Front populaire, qui a obtenu un score marginal, loin de suffire à obtenir le moindre siège aux élections d’octobre 2024.
Ancien chef des services de lutte contre le terrorisme de Suleimanieh, il aurait conservé de nombreux partisans au sein de ces services. Il est accusé d’avoir préparé un coup de force visant à éliminer le chef actuel de la direction de l’UPK.
Aux premières heures du 22 août, les forces de sécurité ont encerclé l’hôtel Lalezar à Suleimanieh pour arrêter Lahur et ses associés, exécutant un mandat délivré par un tribunal local. De violents affrontements ont éclaté vers 3 h du matin et ont duré près de quatre heures, les partisans armés de Lahur échangeant des tirs avec les unités de sécurité. Les affrontements ont fait de nombreuses victimes des deux côtés. Selon les chiffres officiels, trois membres des forces de sécurité ont été tués et 19 blessés lors de la confrontation. Lahur est poursuivi en vertu de l’article 56 du Code pénal irakien, qui couvre le complot criminel. Les autorités judiciaires de Suleimanieh ont indiqué que le mandat d’arrêt mentionnait des accusations de tentative de meurtre et de tentatives de déstabilisation de la sécurité. À la suite de sa détention, les procureurs ont ajouté d’autres charges graves, y compris meurtre avec préméditation, sédition armée au dossier contre Lahur.
Le Conseil de sécurité de la Région du Kurdistan a publié des images de plusieurs hommes, présentés comme des membres du groupe armé de Lahur, avouant le complot. Dans la vidéo, six gardes armés ont décrit des plans visant à louer un appartement dans une tour près du siège de Bafel Talabani et ont montré comment des fusils de sniper munis de silencieux avaient été installés à une fenêtre donnant sur le bureau du dirigeant de l’UPK. Ils ont affirmé que Lahur lui-même avait donné l’ordre d’assassiner son cousin Bafel. Le Conseil de sécurité de la Région du Kurdistan, un organe de sécurité de premier plan, a accusé la faction de Lahur de comploter pour déstabiliser la région en éliminant des dirigeants clés. Les comploteurs auraient visé également Qubad Talabani, vice-Premier ministre et frère cadet de Bafel Talabani, dans leur tentative d’assassinat.
Ces troubles interviennent à quelques mois des élections parlementaires irakiennes dans un contexte régional tendu où le conflit entre l’Iran et Israël, les litiges politiques et financiers persistants entre Bagdad et le Kurdistan font peser de lourdes menaces sur la stabilité du Kurdistan. La population, frappée par la crise économique et les incertitudes politiques, est de plus en plus inquiète.
Dans l’Irak arabe, la situation est encore pire. Malgré plus de 120 milliards de dollars alloués depuis juin 2003 à la mise en place d’un système électrique moderne, le pays souffre d’une pénurie d’électricité.
Le 11 août, à la suite d’une panne géante, l’Irak a été presque totalement privé d’électricité, sauf le Kurdistan qui dispose de ses propres centrales. La panne serait causée par une surconsommation due à la canicule. À Bagdad, à Bassorah, à Kerbala, les températures atteignent souvent les 50 °C et les citadins ont de plus en plus recours à la climatisation.
En raison de la corruption gigantesque de la classe politique, la majeure partie des sommes allouées à la construction de nouvelles centrales électriques a été détournée.
L’Irak, qui importe déjà de l’électricité de l’Iran, qui lui-même souffre de pénuries, pourrait s’approvisionner aussi auprès de la Turquie, au prix fort.
Sur le plan sécuritaire, comme convenu, les Américains ont évacué leurs bases militaires dans la partie arabe de l’Irak et ont redéployé leurs forces au Kurdistan, où leur présence devrait durer au moins encore un an.
Washington maintiendra néanmoins une « coopération stratégique » avec Bagdad et veillera à ce que l’Irak ne bascule pas totalement dans l’orbite de l’Iran.
Sous la pression des Américains, un projet de loi visant à consolider le rôle des anciennes unités paramilitaires pro-iraniennes de Hashd al-Chaabi, et leur assurant une indépendance financière à l’image des Gardiens de la révolution iraniens, a été renvoyé sine die. Washington estime que l’adoption de cette loi « institutionnaliserait l’influence iranienne et consoliderait les groupes armés terroristes, sapant ainsi la souveraineté de l’Irak ».
Le conflit entre Erbil et Bagdad sur le budget et sur l’exportation du pétrole du Kurdistan persiste. Bagdad n’a pas versé les salaires des employés et fonctionnaires du Kurdistan en juillet et en août. L’exportation du pétrole, annoncée chaque semaine pour « très bientôt », n’a toujours pas repris. Son arrêt depuis mars 2023 a déjà coûté plus de 30 milliards de dollars au budget du Kurdistan et de l’Irak.
Les élections parlementaires annoncées pour le 17 novembre 2025 risquent de se dérouler dans un climat tendu, et le mécontentement de la population pourrait se traduire par un vote en faveur des partis populistes et produire un Parlement encore plus fragmenté. Un an après les élections, le Kurdistan n’est toujours pas parvenu à former une nouvelle coalition gouvernementale.
Le programme nucléaire iranien continue d'hypothéquer l'avenir de ce pays, son économie et ses relations extérieures. Quelques semaines après la guerre de 12 jours en juin, au cours de laquelle les principales installations nucléaires ont été gravement endommagées par les bombardements israéliens et américains, les Européens du groupe dit E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) tentent de renouer le fil rompu du dialogue pour régler par des voies diplomatiques la crise nucléaire iranienne. Le temps presse car l'accord nucléaire signé en juillet 2015 et endossé à l'époque par une résolution du conseil de sécurité de l'ONU expire en octobre.
Cet accord n'a pas été respecté. Les États-Unis, sous le premier mandat de Donald Trump, avaient décidé en 2018 de s'en retirer et avaient rétabli leurs propres sanctions. De son côté, l'Iran s'est affranchi de certains engagements, notamment sur l'enrichissement de l'uranium, tout en autorisant les visites des inspecteurs de l'Agence de l'énergie atomique de l'ONU. Les Européens ont, eux, respecté les dispositions de l'accord, notamment celles concernant la suspension des sanctions économiques visant l'Iran. La question est de savoir si celles-ci vont être rétablies en octobre, à l'expiration de l'accord signé en 2015.
Le 26 août, des représentants du trio européen du groupe E3 se sont réunis avec leurs homologues iraniens pour renouer les fils du dialogue et explorer les voies d'un accord diplomatique restreignant le programme nucléaire iranien à des usages purement civils. L'Iran, dans cette perspective, sera autorisé à enrichir son uranium à hauteur de 5 % pour ses centrales nucléaires et à environ 20 % pour les isotopes à usage médical. Mais Téhéran semble rejeter toute limitation de son programme d'enrichissement en faisant une question de "fierté nationale".
En signe d'ouverture ad minima, l'Iran a autorisé une visite des inspecteurs de l'ONU à sa centrale nucléaire de Boushehr, une première depuis la guerre des 12 jours.
Dans ce contexte tendu, le trio du groupe E3 a déclenché le 28 août un mécanisme appelé "snapback", qui permet de rétablir les sanctions contre l'Iran. Les trois puissances européennes laissent ainsi un mois à l'Iran pour négocier et éviter le rétablissement des sanctions suspendues il y a dix ans.
Une réunion à huis clos du conseil de sécurité de l’ONU consacrée à cette question s’est tenue le 29 août à New York. La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a, elle aussi, laissé la porte à la négociation pendant un mois : "Nous entrons dans une nouvelle phase de 30 jours (...) que nous devons vraiment utiliser pour trouver des solutions diplomatiques", a-t-elle déclaré (L’Express, 30 août). Même le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré, le 29 août, que Washington restait ouvert à des pourparlers directs avec Téhéran.
Le mécanisme de "snapback", différent des décisions habituelles du conseil de sécurité, prévoit que les sanctions soient rétablies à l’issue des 30 jours, à moins que le Conseil n’adopte une résolution confirmant la levée des sanctions, une éventualité guère probable qui se heurterait à un ou plusieurs vetos de membres permanents du conseil de sécurité.
Co-signataire de l’accord de 2015, la Russie a exhorté les Européens "à réviser leurs décisions erronées avant que celles-ci n’aboutissent à des conséquences irréparables et à une nouvelle tragédie".
Le rétablissement des sanctions aura en effet un impact dévastateur sur une économie iranienne déjà à bout de souffle. Le rial, la monnaie nationale, est en chute libre. La commission économique du Parlement iranien a approuvé, le 3 août, un projet de loi visant à supprimer quatre zéros de sa monnaie nationale. Le même jour, un dollar s’échangeait au marché noir à 925 000 rials (Le Figaro, 3 août).
La misère s’installe un peu partout. Dans un pays riche en pétrole et en gaz, la population subit des coupures quotidiennes d’électricité et de gaz, d’eau. La sécheresse ne fait qu’aggraver la situation.
Le niveau des réserves d’eau dans les barrages est au plus bas. Il est devenu critique dans la province de Téhéran où les quatre principales retenues d’eau alimentant la capitale ne sont plus remplies qu’à 12 % de leur capacité, contre 60 % à 70 % habituellement (Le Monde, 6 août). Face au mécontentement populaire généralisé, le pouvoir a recours à une répression sans retenue.
Selon l’ONU, 841 personnes ont été exécutées par le régime depuis le début de l’année. L’ONU dénonce "un schéma systématique d’utilisation de la peine de mort comme outil d’intimidation par l’État".
En juillet, l’Iran avait exécuté, selon l’ONU, au moins 110 condamnés, soit le double du nombre de personnes exécutées en juillet 2024. (Le Monde, 29 août ; Le Figaro, 30 août)
Au Kurdistan, les forces de sécurité iraniennes ont mené, en août, des vagues d’arrestations arbitraires, visant des civils, des militants et même des journalistes. Les détenus étaient généralement arrêtés sans mandat ni procédure légale, souvent au milieu de violences, puis emmenés vers des lieux inconnus. Dans de nombreux cas, les familles sont restées dans l’angoisse, sans aucune information sur le sort de leurs proches.
Le 19 août, à Saqqez, quatre villageois kurdes – Omid Rahimzadeh (47 ans), Mehdi Kamali (41 ans), Zakaria Moradi (35 ans) et Mohammad Aminpour (30 ans) – ont été arrêtés sans mandat judiciaire par des agents du Renseignement et emmenés vers un lieu non divulgué. Trois jours plus tard, leur sort et leurs conditions restaient inconnus, aucune charge n’ayant été annoncée.
Le 20 août, à Téhéran, les forces de sécurité de la capitale ont perquisitionné les domiciles de deux frères kurdes de la province de Kermanshah, Ramin Rostami et Ehsan Rostami (38 ans), les arrêtant sans mandat. Ehsan Rostami est un militant culturel kurde bien connu dans le domaine de l’édition, et sa détention – à son domicile privé – est intervenue sans aucune charge annoncée. Les deux hommes ont été emmenés vers des lieux inconnus. Leur famille n’a reçu aucune information, illustrant la façon dont les militants kurdes disparaissent régulièrement dans les centres de détention iraniens pour des activités pacifiques comme le travail littéraire.
Le 9 août, à Ourmia, dans l’un des cas les plus alarmants du mois, des agents du renseignement du CGRI ont arrêté violemment neuf villageois kurdes – tous issus de deux familles liées – sous prétexte de « collaboration avec Israël ». Parmi les détenus figuraient plusieurs membres des familles Golestani et Mostafazadeh, qui ont été sévèrement battus lors de leur arrestation, puis transférés vers un centre de détention à Téhéran. Quatre jours après le raid, aucune information n’avait été fournie sur leur état ni sur leur lieu exact de détention, et les démarches des familles étaient vaines. L’accusation généralisée d’espionnage est infondée et s’inscrit dans un schéma où le régime utilise des conflits extérieurs comme prétexte pour faire des Kurdes des boucs émissaires
Le 7 août, à Sanandaj, le Renseignement du CGRI a arrêté Roghayyeh (Zhino) Karimi, une jeune femme kurde de 18 ans originaire de Marivan, et l’a détenue sans inculpation. Elle a été maintenue au secret dans un centre de Sanandaj sans accès à un avocat ni à des visites familiales tout au long de son interrogatoire. Plus tard dans le mois, Karimi a été transférée dans un centre de détention pour mineurs, mais son statut juridique restait incertain.
L’une des dimensions les plus flagrantes de la répression anti-kurde en Iran est le ciblage des kolbars – les porteurs kurdes qui transportent des marchandises à travers la frontière Iran–Irak par désespoir économique. Les gardes-frontières et forces de sécurité iraniennes continuent de traiter ces civils non armés comme des ennemis combattants, utilisant une force létale et des abus cruels contre eux en toute impunité. Août 2025 a vu plusieurs tirs et meurtres de kolbars.
Le 17 août, Rahman Rasoulzadeh, kolbar de 40 ans originaire de Baneh, a été abattu par les forces du régiment frontalier iranien avec une mitrailleuse lourde DShK. Il a été touché par des balles de gros calibre et est mort sur le coup au poste frontalier de Hengejal. Des témoins oculaires confirment que Rasoulzadeh a été directement visé et ne représentait aucune menace. Son corps a ensuite été traîné jusqu’à un hôpital local. L’usage d’armes de champ de bataille contre un simple porteur illustre l’extrême brutalité de la politique frontalière iranienne. De plus, à Sawlawa, des gardes-frontières iraniens ont ouvert le feu sans avertissement sur un jeune kolbar, Milad Tabad (27 ans), dans les montagnes de Tete à Marivan. Tabad a été grièvement blessé par les tirs le 25 août et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Kosar de Sanandaj en raison de la gravité de ses blessures. Il reste sous surveillance médicale après un traitement d’urgence.
Les organisations kurdes de défense des droits humains ont documenté que ce schéma de violence est systématique. En juillet 2025 (à peine un mois plus tôt), au moins 12 kolbars kurdes ont été tués ou blessés par des tirs directs de gardes-frontières iraniens, un chiffre qu’août semble égaler.
Au-delà des arrestations et fusillades mentionnées, août 2025 a également été marqué par de nombreuses violations des droits culturels, politiques et économiques des Kurdes, soulignant la nature omniprésente de l’oppression du régime :
Fin août, le ministère iranien de l’Éducation a intensifié sa purge des enseignants kurdes impliqués dans l’activisme syndical. Une commission d’appel a confirmé ou alourdi les sanctions disciplinaires contre au moins 7 enseignants kurdes, imposant des peines allant de la révocation définitive et la retraite anticipée forcée à l’exil de plusieurs années loin de leur domicile. Parmi les personnes ciblées figuraient des militants syndicaux de premier plan qui avaient mené des protestations d’enseignants pour de meilleures conditions. Par exemple, le syndicaliste Omid Shah-Mohammadi a été définitivement exclu du système éducatif, et d’autres ont été renvoyés ou suspendus simplement pour leur activisme pacifique.
Défenseur de longue date de la cause kurde, Gérard Chaliand, poète, écrivain et expert en géopolitique, est décédé le 20 août à l'hôpital Broca, dans le 13e arrondissement de Paris, où il était soigné depuis plusieurs mois pour insuffisance rénale. Il avait fêté ses 91 ans le 15 février dernier.
Né en 1934 à Etterbeek, en Belgique, dans une famille d'exilés arméniens rescapés du génocide, il a grandi à Paris, au Quartier Latin où son père tenait une pharmacie. Élève au lycée Henri IV, grand lecteur, il avait lu un livre de souvenirs de l'écrivain Blaise Cendrars intitulé Bourlinguer qui lui avait fait une forte impression. Il avait décidé de partir à son tour parcourir le vaste monde, voyager, découvrir de nouveaux pays, d'autres cultures, d'autres civilisations.
C'est ainsi qu'il est parti à l'âge de 16 ans en Algérie, où il a vécu quelque temps de petits boulots de survie et découvert les rudes réalités du colonialisme. Ce séjour formateur le conduira plus tard à s'engager dans les réseaux de soutien au Front national de libération de l'Algérie, et plus tard dans divers mouvements révolutionnaires du tiers-monde.
Après le baccalauréat, il a étudié à l'École nationale des langues orientales (Langues O’), où il a appris le turc, suivi des cours sur les civilisations orientales, notamment celles de l'Iran, de l’Inde et de la Chine. C’est là qu’il a, à l’âge de 22 ans, fait la connaissance de Juliette Minces, 19 ans, secrétaire de la section du Parti communiste et étudiante en langue et civilisation chinoises, qui devient le grand amour de sa vie.
Il entreprend avec elle un grand voyage à travers la Turquie, le Kurdistan, l’Iran jusqu’aux Indes, dont la grande misère, le système archaïque des castes, les discriminations et les violences le marqueront.
À Istanbul, il fréquente des intellectuels turcs de gauche tels qu’Atilla Tokatli, qui commencent à traduire en turc les classiques du marxisme. Ils lui font découvrir la poésie populaire turque, dont il traduira quelques poèmes en français, qui sont publiés en 1961 aux éditions Maspéro, avec des poèmes populaires kurdes traduits grâce aux concours de l’émir Kamuran Bedir Khan, sous le titre Anthologie de la poésie populaire Turcs et des Kurdes.
Sa rencontre aux Langues O’ avec l’émir Bedir Khan, qui y enseignait la langue et la civilisation kurdes, l’a incité à publier la même année un opuscule sous le titre La question kurde qui, à un moment où les Kurdes étaient encore très peu connus en France, a été une bonne contribution pour les faire connaître.
Militants engagés du côté des indépendantistes algériens, Gérard Chaliand et Juliette Minces ont vécu quelque temps dans l’Algérie indépendante où ils ont travaillé pour la revue Révolution africaine. À la suite du coup d’État de Boumédiène, tous les militants qui avaient placé leurs espoirs révolutionnaires dans l’Algérie « socialiste » ont dû déchanter et partir ailleurs.
On retrouve alors Chaliand dans l’activisme révolutionnaire international autour de la Tricontinentale, dont le cœur bat à Cuba et dont les idées sont portées en France par la revue Partisans publiée à Paris par François Maspéro, dont Chaliand est un contributeur régulier.
Il traduit, avec Juliette Minces, La guerre de guérilla et autres textes militaires de Che Guevara, 1961.
Plus tard, on le verra en Afrique, en Guinée-Bissau, où il rencontre Amílcar Cabral, organisant la guerre d’indépendance de son pays, une expérience révolutionnaire que Chaliand fait connaître dans La lutte armée en Afrique (Maspéro, 1967).
Il ira ensuite séjourner au Vietnam longuement pour suivre de près la résistance vietnamienne contre la guerre américaine et publiera sur cette expérience Les Paysans du Nord-Vietnam et la guerre (Maspéro, 1968).
Il passera aussi plusieurs mois au Proche-Orient auprès de divers mouvements palestiniens. Il publie, en 1970, La résistance palestinienne aux éditions de Seuil.
Après tant d’années passées auprès des guérillas et des mouvements insurrectionnels sur plusieurs continents, il soutient en 1975 une thèse de doctorat à l’université Paris V, sur les Mythes révolutionnaires du tiers-monde, qui paraît sous forme de livre en 1976 aux éditions du Seuil.
Ce livre critique de maturité marque un tournant dans sa pensée, ses engagements et son œuvre, qui s’oriente de plus en plus vers la stratégie, les guerres irrégulières et la géopolitique, avec la publication d’une série d’atlas, d’anthologies des écrits sur les guérillas, sur les textes fondamentaux des penseurs de la stratégie, etc.
Parallèlement à ces activités éditoriales, à ses voyages d’études dans de nombreux pays, à ses reportages sur les insurrections et les guérillas en cours en Érythrée, en Afghanistan, en Angola, en Amérique du Sud, il consacre une partie de son temps à la cause kurde.
Il participe, avec Kendal Nezan et l’ethnologue Sabine Hargous à la création en 1973 d’une association France-Kurdistan pour faire connaître le peuple kurde, sa culture, son histoire et sa lutte de libération nationale.
Parrainée par d’intellectuels français prestigieux comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwartz, Maxim Rodinson, l’association publie un bulletin intitulé Solidarité Kurdistan et réédite aux éditions d’Aujourd’hui l’ouvrage de référence Les Kurdes, étude historique et sociologique de Basil Nikitine.
Puis, sous sa direction est élaboré et publié un ouvrage collectif intitulé Les Kurdes et le Kurdistan en 1978 (éditions Maspéro) avec les contributions d’Abdul Rahman Ghassemlou, Kendal Nezan et Ismet Chérif Vanly.
C’est Chaliand qui, grâce à ses relations dans les milieux de l’édition, assure la traduction en anglais (People without a Country, Zed Press,1984), en allemand (Kurdistan und die Kurden, 1984), en grec (Οί Koύρδoι, 1988) et en d’autres langues de cet ouvrage écrit par des intellectuels kurdes présentant leur version de l’histoire de leur peuple.
Il organise, avec le concours de Cultural Survival Inc. Boston, une série de conférences (Lectures tour) dans les principales universités américaines pour animer des débats autour de People Without a Country, afin de faire connaître les Kurdes à la jeunesse étudiante américaine.
Secrétaire général de France-Kurdistan jusqu’en 1982, Gérard Chaliand a participé à la création en 1983 de l’Institut kurde de Paris, dont il est resté un membre actif jusqu’à la fin sa vie.
Il a participé à la plupart des colloques et conférences organisés par l’Institut kurde, trouvé des éditeurs pour ses publications, pour les livres des auteurs kurdes ou sur les Kurdes, comme Le Génocide en Irak, La République kurde de William Eagleton ou Une Européenne chez les Kurdes d’Hélène Krulich-Ghassemlou.
Il a réédité aux éditions de l’Aube son excellente Anthologie de la poésie populaire kurde, avant de publier lors de l’exode massif consécutif à la guerre du Golfe, Le malheur kurde, Seuil, 1992 (Traduction en anglais sous le titre de The Kurdish tragedy, UNRISD, 1994).
Il considérait l’épopée kurde Memê Alan, dans sa belle traduction par Roger Lescot, comme l’un des plus beaux textes du patrimoine littéraire universel et tenait à en insérer des passages dans ses anthologies des Trésors des textes épiques de l’humanité (Plon, 1995) et Mon anthologie universelle de l'amour, (Les Belles lettres, 2023).
Au cours de son long compagnonnage avec les Kurdes, Gérard Chaliand a connu la plupart des leaders et des intellectuels kurdes.
Il s’est lié d’amitié avec A.R. Ghassemlou, Nechirvan Barzani, Yılmaz Güney, qu’il admirait beaucoup pour son cinéma et son courage physique et moral. Güney fut la première personnalité de renom originaire de Turquie qui témoigna publiquement, en 1984, devant le Tribunal permanent des peuples à Paris, du génocide perpétré en 1915 par l’Empire ottoman contre le peuple arménien.
Sa prise de position avait suscité de vives réactions en Turquie et contribué au débat sur la responsabilité de l’État turc, qui continue sa politique de déni.
Chaliand a fait de nombreux séjours au Kurdistan iranien, puis irakien et syrien (Rojava).
Il a enseigné pendant plusieurs années à l’université du Kurdistan à Erbil, et chaque année, il passait près de 4 mois dans la capitale kurde, où il connaissait à peu près tout le monde. Il y était aimé et apprécié.
Sa dernière visite au Kurdistan remonte à mai 2023, où il a participé, en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de Bernard Kouchner, de Joyce Blau et de Kendal Nezan, à l’inauguration du Musée Barzani.
Avec lui disparaît une grande voix, un défenseur fidèle de la cause kurde.
Ayant fait don de son corps à la science, à l’instar de l’émir Bedir Khan, il n’y a pas eu d’obsèques.
L’Institut kurde organise le 3 octobre 2025 à 19h une soirée d’hommage à la Maison d’Amérique latine à Paris avec la participation de ses proches et de ses amis.
Écrits de Gérard Chaliand sur les Kurdes.
Gérard Chaliand a publié près d’une centaine de livres, dont des recueils des poésies, des atlas, des anthologies, des livres de géopolitique et de stratégie. Nombre de ses ouvrages ont été traduits en anglais et en d’autres langues.