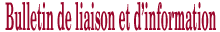Après plus de deux ans et demi de suspension, l'exportation vers la Turquie, via l'oléoduc Fish Khabour-Ceyhan, du pétrole produit dans la Région fédérée du Kurdistan a repris le 27 septembre.
Les négociations entre Erbil, Bagdad et les compagnies pétrolières, qui duraient depuis mars 2023, ont finalement abouti à la signature d'un accord tripartite le 25 septembre à Bagdad. Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani a annoncé lui-même cet accord « historique » permettant l'exportation sous supervision fédérale du pétrole kurde. Le Premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, a salué cet accord, qualifié d'historique, ouvrant la voie à l'exportation sereine du pétrole de la Région du Kurdistan vers les marchés mondiaux.
De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que l'accord tripartite avait été "facilité" par les États-Unis et qu'il "renforçait le partenariat économique (...) entre les États-Unis et l'Irak". Le Royaume-Uni et la France ont également apporté leur soutien à cet accord servant les intérêts de toutes les parties, et ont félicité Bagdad et Erbil pour leurs efforts de régler les problèmes par le dialogue (Rudaw, 26.9).
L'accord tripartite comporte 20 articles. Il prévoit la livraison par le ministère des ressources naturelles du Kurdistan de 190 000 barils par jour à la compagnie nationale irakienne,SOMO chargée de son exportation et de sa commercialisation. Une quantité de 50 000 barils par jour serait par ailleurs gardée pour la consommation domestique selon le directeur de la SOMO, Ali Nizar. Le pétrole kurde destiné à l'exportation sera livré à la station de Fish Khabour, située à la frontière de la Région du Kurdistan avec la Turquie et la Syrie, connectée à l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan, dont le terminal est le port méditerranéen turc de Ceyhan.
L'accord reconnaît de facto les arrangements conclus entre le gouvernement du Kurdistan et les compagnies pétrolières opérant dans la région sur le partage des revenus de l'exploitation. Ainsi, les compagnies internationales partenaires de l'accord percevront 16 dollars par baril pour frais de production et de transport, un coût qui pourra être révisé après la remise du rapport final de la société d'audit Wood Mackenzie.
L'accord tripartite est conclu d'abord pour une période de 30 jours, qui peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2025. En cas de litige, les parties peuvent saisir le Tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris. C’est ce tribunal, saisi par l’Irak, qui avait condamné la Turquie en mars 2023 pour le non-respect d’un accord signé avec le régime de Saddam Hussein sur les conditions de l’exportation du pétrole de l’Irak via l’oléoduc Kirkouk-Ceyhan.
En autorisant le transit via cet oléoduc du pétrole du Kurdistan, sans l’aval du gouvernement de Bagdad, la Turquie aurait enfreint cet accord. À la suite de cet arbitrage, l’exportation du pétrole kurde via la Turquie a été suspendue en mars 2023.
L’Association de l’industrie pétrolière du Kurdistan (APIKUR), qui représente les compagnies pétrolières internationales opérant au Kurdistan, a estimé les pertes pour toutes les parties à plus de 35 milliards depuis la suspension des exportations en mars 2023 (AFP, 23.9).
L’accord tripartite stipule aussi que ces compagnies pétrolières doivent rencontrer les autorités du Kurdistan dans les 30 jours suivant la reprise des exportations « pour travailler à la création d’un mécanisme de règlement des dettes en souffrance » qui leur sont dues et qui s’élèveraient à un milliard de dollars.
L’un des opérateurs pétroliers majeurs, le groupe norvégien DNO ASA, a annoncé qu’il ne rejoignait pas l’accord, affirmant que la reprise des exportations devait se faire « conformément à des accords qui garantissent la sécurité des paiements ».
Les gisements pétroliers de Kirkouk ne sont pas concernés par cet accord car cette province à majorité kurde est, depuis octobre 2017, sous contrôle du gouvernement fédéral irakien, qui commercialise directement sa production pétrolière, via l’oléoduc de Bassorah.
Membre fondateur de l’OPEP, l’Irak exporte en moyenne 3,4 millions de barils par jour, selon l’agence de presse officielle INA, citant des chiffres de la SOMO. L’exportation de l’or noir fournit à l’Irak 90 % de ses revenus.
Dans ce climat de compromis, Bagdad a approuvé le 23 septembre le versement des salaires du mois de juillet pour les employés, fonctionnaires et retraités du Kurdistan, à condition qu’Erbil transfère 120 milliards de dinars irakiens (environ 80 millions d’euros) de recettes non pétrolières comme part du budget fédéral.
Le Gouvernement régional du Kurdistan a affirmé que les fonds avaient été déposés auprès du ministère fédéral des Finances. Aucune date n’a été fixée pour le versement des salaires d’août et de septembre 2025.
En dépit des incertitudes et difficultés financières, le gouvernement du Kurdistan poursuit ses projets d’infrastructure. Selon le ministre de la Construction Dana Abdulkarim, cité par Rudaw (25.9), le gouvernement de coalition actuel a, en cinq ans, construit ou réhabilité 2 681 km de routes pour un coût total de 763 millions de dollars.
Par ailleurs, selon le général Babekir Zebari, conseiller militaire en chef du président du Kurdistan et ancien chef d’état-major de l’armée irakienne, le processus d’unification et de modernisation des forces de Peshmergas devra être complété fin 2026. Les unités issues des forces des maquis de la résistance kurde seront regroupées en 11 brigades. 10 de ces brigades sont déjà unifiées. Elles seront toutes placées sous le commandement du Ministère des Peshmergas et réparties entre deux zones géographiques.
Ce processus est suivi de près par les forces américaines de la coalition internationale de lutte contre Daech, qui entraînent, forment, équipent et conseillent les forces de Peshmergas pour en faire une armée moderne, capable d’assurer la sécurité du Kurdistan et de contribuer à celle de l’Irak.
Les Peshmerges mènent régulièrement des opérations conjointes avec l’armée irakienne contre Daech.
L’Irak, qui se considère désormais assez sûr et en mesure de se défendre, a demandé le retrait des forces armées de la coalition internationale.
Celles-ci, dont 2 500 militaires américains, ont évacué leurs bases dans l’Irak arabe pour se redéployer au Kurdistan, qui leur sert aussi de base pour leurs opérations en Syrie.
Au Kurdistan, malgré une réunion « au sommet » entre le président du PDK, Massoud Barzani, et le chef de l’UPK, Bafel Talabani, le 27 septembre à Pirmam, près d’Erbil, les négociations pour la formation d’un nouveau gouvernement de coalition n’ont toujours pas abouti, faute d’accord sur la répartition des portefeuilles.
L’UPK, en dépit de son score faible aux élections parlementaires d’octobre 2024, réclame une coalition paritaire, exigeant la moitié des postes ministériels. Elle semble espérer obtenir de bons résultats aux élections pour le Parlement fédéral irakien le 11 novembre, afin d’être en meilleure position face au PDK pour une négociation globale sur les postes à pourvoir à Bagdad et au gouvernement du Kurdistan.
Les deux partis sont actuellement associés dans ce que le gouvernement du Kurdistan qualifie d’« exécutif chargé des affaires courantes ».
Après l'échec des négociations menées par le groupe dit E3, comprenant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, pour encadrer le programme nucléaire iranien, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a, dans la soirée du 27 septembre, rétabli les sanctions économiques et militaires suspendues depuis la signature de l'accord nucléaire de 2015.
Ces sanctions vont d'un embargo sur les armes à des mesures économiques restreignant sévèrement les investissements étrangers en Iran et le commerce avec le pays. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a rejeté le 28 septembre des négociations susceptibles d'engendrer de « nouveaux problèmes » : "Nous avons toujours déclaré notre disponibilité à un dialogue logique, équitable et juste fondé sur des critères clairs, mais nous n'accepterons jamais des négociations qui nous causeraient de nouveaux problèmes et difficultés". Sa logique, apparemment, n’est pas celle des Occidentaux car après plusieurs réunions infructueuses, le trio européen avait jugé que Téhéran n'avait pas fait de "gestes concrets pour répondre à ses trois conditions : reprise des négociations avec les États-Unis, accès de l'AIEA aux sites nucléaires sensibles de Fordow, Natanz et Ispahan ; processus pour sécuriser le stock d'uranium enrichi".
Le président iranien a affirmé que les États-Unis avaient exigé de l'Iran de lui remettre « tout son uranium enrichi » en échange d'une prolongation de trois mois de la suspension des sanctions. "Ils veulent que nous leur cédions tout notre uranium enrichi", a-t-il déclaré à la télévision d'État, "et dans quelques mois ils auront une nouvelle exigence".
Européens et Américains ont immédiatement affirmé que le rétablissement des sanctions ne marquait pas la fin de la diplomatie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé Téhéran à accepter des discussions directes, "en toute bonne foi", tout en demandant à tous les États d'appliquer "immédiatement" les sanctions pour faire "pression sur l'Iran".
Les ministres français, britanniques et allemands des Affaires étrangères ont eux assuré dans un communiqué commun qu'ils continuaient de chercher "une nouvelle solution diplomatique garantissant que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire" (Le Figaro, 28 septembre). La Russie et la Chine avaient proposé, le 26 septembre, au Conseil de sécurité de prolonger de six mois la suspension des sanctions afin de donner plus de chances à la diplomatie. Sans succès. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a accusé les Occidentaux de "saboter" la diplomatie, affirmant que pour Moscou le rétablissement des sanctions est "légalement invalide" et que la décision de l'ONU ne peut pas être appliquée. La Russie et la Chine étant les principaux partenaires commerciaux, le succès éventuel des sanctions dépendra beaucoup de leur politique envers l’Iran.
Dès l'annonce des sanctions, la monnaie iranienne, le rial, a dégringolé vers un niveau le plus bas de son histoire, s'échangeant à 1,1 million de rials contre 1 dollar américain, contre environ 900 000 rials début août. La population, désespérée, craint aussi que l'entêtement des dirigeants iraniens à poursuivre leur programme nucléaire ne conduise à une nouvelle guerre dévastatrice entre les Israéliens et les Américains, crainte d’autant plus vive que selon Israël, le programme nucléaire iranien n'a pas été anéanti (Le Monde, 12 septembre), laissant clairement entendre qu'il finira tôt ou tard le travail.
Très affaibli, le régime a un recours de plus en plus massif à la répression pour étouffer toute forme d'opposition et de contestation afin d'assurer sa survie. Ainsi, selon un décompte publié le 23 septembre par l'ONG Iran Human Rights (IHR), depuis le début de l'année 2025 au moins 1000 personnes condamnées à mort ont été exécutées. Ce chiffre, le plus élevé depuis 2008, dépasse déjà le record de 975 exécutions enregistrées en 2024.
À la mi-septembre, date du troisième anniversaire de la mort de la jeune étudiante Jina Mahsa Amini, au moins 64 exécutions ont été enregistrées en une semaine, soit une moyenne de 9 exécutions par jour pour terroriser la population (Libération, 23.9).
Le 2 septembre, Mohammad Babaei, un Kurde de 44 ans originaire du village de Dezli à Sarvabad, a été pendu dans la prison centrale de Sanandaj pour des accusations liées à une affaire de meurtre. Cinq jours plus tard, le 7 septembre, Azad Moradi, un Kurde de Baneh, a été exécuté dans la même prison. Sa mort est survenue un jour où six autres prisonniers ont été exécutés à travers l’Iran. L’affaire la plus politiquement chargée est survenue le 17 septembre, lorsque les autorités ont exécuté Babak Shahbazi dans la prison de Ghezel Hesar à Karaj. Prisonnier politique kurde accusé d’espionnage pour Israël, son dossier a été entaché de torture, d’aveux forcés et du refus d’une dernière visite familiale. Son exécution a démontré une fois de plus que la peine de mort en Iran dépasse largement le droit pénal et sert d’arme contre la dissidence politique. La même semaine, trois autres hommes kurdes ont été exécutés à Ilam et Karaj, dans une série noire où en deux semaines au moins vingt personnes ont été pendues à travers le pays. Le 21 septembre, trois prisonniers kurdes — Saeed Ghobadi, Kazem Jamashourani et Hadi Nowruzi — ont été exécutés à la prison de Dizelabad à Kermanshah. Quelques heures plus tôt, un autre prisonnier kurde de Sarpol-e Zahab, Saeed Qubadi, y avait également été pendu.
Le troisième anniversaire de la mort de Jîna Amini, le 16 septembre 2025, a servi de catalyseur à une vaste et sévère répression préventive dans les régions kurdes d’Iran (Rojhelat). L’objectif du régime était clairement de neutraliser toute mobilisation potentielle de la société civile associée au mouvement « Femme, Vie, Liberté ».
Dans les villages, les bourgs et les villes, les forces de sécurité ont mené des raids, arrêté des civils sans procédure régulière et pris pour cibles aussi bien des enfants que des adultes. À la mi-septembre, l’activiste civil Hamid Chapati a été envoyé à la prison d’Ourmia, tandis qu’à Kamyaran, deux enfants kurdes ont été arrêtés par les forces du renseignement. Le 12 septembre, un tribunal révolutionnaire d’Ourmia a prononcé une condamnation à mort contre Nasser Bekrzadeh, âgé de 25 ans, et dix ans de prison contre Shahin Vasaf pour des accusations d’espionnage, malgré des jugements antérieurs ayant annulé leurs peines capitales initiales. À Kamyaran, quatre enfants et un adulte ont été arrêtés à la mi-septembre, poursuivant le schéma alarmant de ciblage des mineurs. Le 16 septembre, vingt-deux groupes de défense des droits et des figures publiques éminentes ont lancé un appel exigeant des soins médicaux urgents pour Zeynab Jalalian, militante kurde emprisonnée depuis longtemps. Le même jour, des gardes de la mine d’or de Saqqez ont ouvert le feu sur des villageois protestant contre des dommages environnementaux, tuant un jeune agriculteur et blessant quatre autres. Malgré les menaces et une forte présence sécuritaire, des commerçants de Saqqez et de Diwandarah ont fait grève le lendemain pour marquer l’anniversaire de la mort de Jîna Amini — un geste de défi face aux tentatives de l’État de faire taire la mémoire publique.
À Sanandaj, les forces de sécurité ont interrogé Nahiyeh Rahimi, la mère âgée de 71 ans du manifestant tué Ramin Fatehi, la menaçant pour avoir visité la tombe de son fils. Le 18 septembre, deux garçons de 16 ans d’Oshnavieh (Shinno), Diyar Gargol et Alan Tabnak, ont été arrêtés lors de raids nocturnes, et leur sort demeure inconnu. Le lendemain, les forces de sécurité ont arrêté un autre adolescent, Zanyar Shadi-Khah, ainsi qu’un jeune homme, Mohsen Dahar. Ce même jour à Sanandaj et Diwandarah, deux civils kurdes, Zana Mansouri et Mohammad Salehi, ont été arrêtés, là encore sans divulgation de leur lieu de détention. Le 23 septembre, les forces du Service du Renseignement ont fait irruption dans le village de Selin à Sarvabad avec dix-huit véhicules, perquisitionnant les maisons, détruisant des biens et arrêtant Mostafa Advaei, enseignant à la retraite, ainsi que son neveu de 23 ans, Kioumars Advaei. Comme pour tant d’autres arrêtés ce mois-ci, leur sort reste inconnu.
Les kolbars, porteurs frontaliers kurdes, ont continué à faire face à une violence meurtrière en septembre. Le 25 septembre, les gardes-frontières iraniens à Baneh ont abattu Qasem Azizi, un père de deux enfants âgé de 47 ans, après leur avoir prétendument dit qu’ils étaient libres de partir avant d’ouvrir le feu. Son corps a été transféré à l’hôpital Salah al-Din Ayoubi de la ville. Le 16 septembre, Mohammad Abdi, 37 ans, a été gravement blessé par balles dans la zone frontalière de Maleh Khor à Sarvabad. Il a subi des blessures à la jambe et au dos et a dû être transporté à Sanandaj (Senna) pour y être soigné (Hengaw, 16 sept. 2025). Le 23 septembre, trois kolbars ont été blessés à Nowsud. Parmi eux, Karwan Almasi de Salas Babajani a subi une grave blessure à la main, tandis que les deux autres ne sont pas nommés (Hengaw, 23 sept. 2025). Les groupes de défense des droits notent que depuis janvier, des dizaines de kolbars kurdes ont été tués ou blessés, souvent abattus sans avertissement.
Depuis les élections municipales de mars 2024 où, avec le soutien du parti pro-kurde DEM, il a été victorieux dans les grandes métropoles du pays, telles Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, le Parti républicain du peuple (CHP) est dans le viseur du pouvoir. Celui-ci cherche par tous les moyens judiciaires, politiques et médiatiques à sa disposition à affaiblir, à diviser, à discréditer le plus vieux parti du pays, fondé il y a un siècle par Mustafa Kemal Atatürk lui-même.
Le CHP, parti unique jusqu’en 1946 qui, lorsqu’il détenait le monopole du pouvoir, ne ménageait guère les oppositions kurde, communiste ou islamique, se retrouve, par une ironie de l’histoire, à son tour l’objet des manœuvres et manigances du pouvoir islamique en place décidé à empêcher toute alternance.
Après avoir embastillé, en mars dernier, le populaire maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, pour des prétextes souvent fallacieux et avant même tout procès en due forme, le pouvoir s'en prend systématiquement, les unes après les autres, aux municipalités dirigées par le CHP et fait arrêter ses élus en les accusant de corruption, détournements de fonds publics, trucage des marchés publics, etc.
La dernière municipalité en date victime de ces pratiques judiciaires expéditives, la ville de Bayrampaşa, un district d'Istanbul dont le maire et des dizaines d'élus ont été arrêtés le 14 septembre (Le Monde, 15.9).
La justice aux ordres passe désormais à l’étape suivante : la décapitation du CHP. Le 13 septembre, un tribunal a révoqué la direction du CHP à Istanbul pour des irrégularités présumées lors de son congrès de 2023. Selon le jugement, cité par l'AFP, le tribunal a annulé les résultats du congrès provincial, excluant le chef du CHP à Istanbul Özgür Çelik ainsi que les 195 membres de la direction et délégués du parti.
Le tribunal souligne que sa décision implique "la destitution provisoire du président provincial, du comité exécutif provincial et du comité disciplinaire élus au cours de ce congrès", et la nomination par le tribunal d’un comité provisoire qui serait jugé approprié.
"La décision du tribunal est politiquement et légalement nulle et non avenue", a réagi le président du CHP, Özgür Özel. "Nous ne la reconnaissons pas. Que chacun sache, nous ne capitulerons pas", a-t-il déclaré en promettant de faire appel de ce jugement.
Cependant, constatant que malgré les mobilisations populaires massives de soutien, l'étau judiciaire se resserre autour de son parti et de sa direction, menacée à son tour de destitution, le président du CHP a convoqué un congrès extraordinaire de son parti pour le 21 septembre.
Le 5 septembre, quelque mille délégués du parti ont déposé une demande auprès des autorités électorales pour organiser dans les formes ce nouveau congrès. Le temps presse, car la direction du parti fait l’objet de poursuites judiciaires pour "irrégularités" qui auraient été commises lors du congrès ordinaire de novembre 2023 qui l’a élu comme président du parti.
À la suite de cette convocation d’un congrès extraordinaire, le tribunal d’Ankara, qui risquait, lors de son audience du 15 septembre, de prononcer la destitution de la direction du CHP, a finalement reporté sa décision au 24 octobre.
Réuni à Ankara, le 21 septembre, le congrès extraordinaire a réélu à la quasi-unanimité le président sortant Özgür Özel et reconduit son équipe de direction.
Le principal parti de l’opposition, arrivé premier dans les urnes en mars 2023, assure pour l’instant sa survie.
Mais pour combien de temps, dans un pays où la justice est devenue un outil de persécution au service du pouvoir en place, et où Özgür Özel fait l’objet d’une dizaine de poursuites judiciaires ? Et où, désigné comme candidat à la prochaine élection présidentielle par plus de 15 millions de citoyens, le maire d’Istanbul est toujours en prison sans avoir été jugé, où un ancien député et candidat à l’élection présidentielle, Selahattin Demirtaş, est depuis dix ans derrière les barreaux, malgré deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme demandant sa libération.
L’opinion turque, étant depuis une dizaine d’années habituée à la destitution des maires kurdes élus pour des liens supposés avec "une organisation terroriste", et leur remplacement par des fonctionnaires nommés, préfets ou sous-préfets, voit cette pratique s’étendre désormais aux municipalités turques tenues par le principal parti de l’opposition — et risque de décapiter ce dernier.
Les défenseurs des droits humains alertent sur le risque de "déconstitutionnalisation", processus au cours duquel la constitution est en vigueur mais ne s’applique pas à certains segments de la société, essentiellement les Kurdes et maintenant les partis de l’opposition.
En fait, si cette tendance se confirmait, on passerait d’une autocratie élue à une forme de dictature.
L’autre fait marquant du mois a été la rencontre Trump-Erdogan, d’abord brièvement en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, puis plus solennellement à la Maison Blanche le 25 septembre.
Le président Trump a fait preuve de prévenance et d’égards envers « son ami Erdogan ». La rencontre a été suivie d’un déjeuner de travail. Elle a porté sur les relations américano-turques, la situation en Syrie et le conflit israélo-palestinien.
Les questions litigieuses comme l’exclusion de la Turquie du programme des F-35 ou le procès contre la banque publique turque Halkbank, poursuivie par un tribunal de New York pour avoir massivement violé les sanctions américaines contre l’Iran, ont été abordées, sans toutefois parvenir à des résultats concrets.
Si l’achat des avions F-16 est, en principe, acté depuis l’administration Biden, les sanctions américaines encore en vigueur empêchent la Turquie d’acquérir des moteurs d’avion indispensables pour le développement de son futur avion de combat Kaan ou de moteurs pour son futur porte-avions géant, plus grand que le Charles-de-Gaulle français, dont la construction a été annoncée le 2 septembre à grand renfort de publicité (Le Figaro, 2.9).
A part la promesse d’un prochain cessez-le-feu à Gaza et quelques amabilités d’usage, le président turc semble rentrer bredouille de cette visite à la Maison Blanche où il n’avait pas remis les pieds sous Biden. Trump s’est même permis de taquiner publiquement son hôte sur les élections truquées : « que vous connaissez mieux que quiconque ! ».
Le président américain a, pour la première fois, demandé publiquement à la Turquie de ne plus acheter de pétrole russe (Le Monde, 26 septembre).
Tout au long du mois de septembre, la "Commission parlementaire pour la démocratie et la fraternité" a poursuivi ses auditions. Le 24 septembre, son président, Numan Kurtulmuş, qui est également président du Parlement, a publiquement précisé que la question de l’audition d’Abdullah Öcalan avait été exclue de l’ordre du jour de la commission.
Toutefois, le 15 septembre, pour la première fois depuis six ans, le fondateur du PKK a été autorisé à voir ses avocats dans sa prison d’Imrali.
Selon lui, "le processus de paix et de société démocratique a atteint le stade de solution légale" (AFP, 17 septembre).
Le 30 septembre, dans un message relayé par le parti DEM, il semble reprocher au gouvernement de tenter de créer "l’illusion" d’une défaite militaire, de ne parler que de désarmement sans aborder le projet d’une solution politique.
Le 1er septembre, un conseiller juridique du président turc, Mehmet Uçum, avait affirmé que la Turquie devra modifier sa constitution pour avancer sur la voie de la paix avec le PKK, tout en excluant tout statut spécifique pour les Kurdes.
Pour lui, « l’État du peuple kurde est la République de Turquie. La Turquie est la patrie du peuple kurde », une thèse démagogique dans un pays qui ne reconnaît même pas aux Kurdes le droit d’enseigner leur langue dans les écoles publiques !
À signaler aussi qu’en septembre, la Turquie a connu son lot de nouveaux scandales, dont la vague #MeToo qui balaie le pays, l’arrestation des dirigeants du conglomérat Can Holding et la mise sous tutelle administrative de leurs sociétés et de leurs chaînes de télévision, tombées en disgrâce pour des raisons non encore rendues publiques.
Ces scandales occupent les médias et occultent les drames de la grave crise économique et sociale que traverse le pays.
Le processus de légitimation du nouveau régime syrien a connu un nouveau succès diplomatique avec la prise de parole à la tribune de l'ONU de son président par intérim Ahmed al-Charaa le 24 septembre.
« La Syrie reprend la place qui lui revient parmi les nations du monde », a-t-il déclaré dans son allocution, la première d'un chef d'État syrien aux Nations unies depuis 1961. Le djihadiste repenti est le premier dirigeant d’un pays sous sanctions à s’adresser à la tribune des Nations unies.
Au cours de son séjour, il a rencontré nombre de chefs d’État, dont le président Macron, le président turc Erdogan et d'autres dirigeants des pays arabo-musulmans. Il a même participé au sommet Concordia, un forum des affaires mondiales, où il a rencontré le général américain David Petraeus, ancien commandant des forces américaines en Irak, qui avait en 2005 fait arrêter et emprisonner ce djihadiste zélé.
« À une époque, nous étions au combat et maintenant nous passons au discours », a ricané al-Charaa. De son côté, le général américain a salué "son parcours de leader insurgé à chef d'État, une des transformations politiques les plus spectaculaires de l’histoire récente du Moyen-Orient" (Le Monde, 25 septembre).
Selon le président syrien par intérim, "la Syrie, autrefois exportatrice de crises, possède une occasion historique d’apporter la stabilité, la paix et la prospérité à la Syrie et à toute la région". Il a promis une politique de "zéro problème avec les voisins".
Ainsi, la Syrie et Israël, techniquement en état de guerre, vont conclure "plusieurs accords de sécurité d'ici à la fin de l’année", a déclaré à l’AFP, le 18 septembre, une source au ministère syrien des Affaires étrangères.
"Il y a des progrès dans les négociations avec Israël. Il y aura plusieurs accords avant la fin de l’année, en premier lieu des accords militaires et de sécurité", a précisé cette source (Le Figaro, 18 septembre).
Sur le plan intérieur, de vives tensions avec les Alaouites, les Druzes et les Kurdes persistent.
Le 16 septembre, un plan pour "pacifier" le sud de la Syrie, peuplé de Druzes, a été adopté par Damas, soutenu par les États-Unis et la Jordanie, mais pas par Israël.
Le plan prévoit d’apaiser cette région en proie aux violences entre communautés cet été, qui ont fait plus de 2000 morts. Pour le régime de Damas, c’est un moyen de reprendre le contrôle de cette région dissidente.
Les négociations avec les Kurdes sur la question de l'intégration de leurs forces à l’armée syrienne n'ont guère avancé. Damas, qui veut instaurer un régime islamiste centralisateur, demande que des membres des forces kurdes s’intègrent à titre individuel, alors que les Kurdes, qui ont des forces armées aguerries, disciplinées et assez bien équipées, souhaitent être considérés comme une partie de l’armée syrienne en formation à partir d’un conglomérat hétéroclite de dizaines de milices aux allégences fluctuantes.
Les Kurdes insistent sur un système décentralisé pour permettre aux composantes non arabes ou musulmanes de la population, comme les Alaouites, Druzes, Chrétiens et Kurdes, de gérer localement leurs affaires dans le cadre de l’unité territoriale de l’État syrien.
Pour flatter les éventuelles ambitions personnelles, Damas se dit prêt à offrir au commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), le général Mazloum Abdi, ou à un autre général des FDS, le poste de ministre de la Défense ou celui de chef d’état-major de l’armée syrienne, selon la négociatrice en chef kurde Ilham Ahmed (Kurdistan24, 28 septembre).
Sans exclure une telle éventualité, les dirigeants kurdes veulent que leurs forces soient considérées comme un corps d’armée autonome, un peu à l’exemple des forces de Peshmergas kurdes en Irak.
Cependant, le régime syrien ne parvient toujours pas à exercer un contrôle effectif sur les milices disparates qui sont censées faire partie de son armée et qui continuent leurs pratiques de rançons, d’enlèvements, de spoliation, quand elles ne provoquent pas d’incidents meurtriers contre les Kurdes.
Ainsi, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), le 20 septembre, des milices se réclamant de l’armée syrienne ont bombardé le village d’Umm Tina dans la province d’Alep, tuant sept civils, dont cinq femmes et deux enfants.
Le district de Deir Hafer, où se trouve ce village, est situé sur la ligne séparant l’armée syrienne et les Forces démocratiques syriennes (FDS). Il est le théâtre d’affrontements périodiques entre les deux camps, selon l’OSDH, qui rappelle qu’il s’agit là du plus lourd bilan dans la région depuis des mois (AFP, 20 septembre).
L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) et les médias locaux ont aussi rapporté une embuscade meurtrière de Daech le 24 septembre dans la région rurale de Deir ez-Zor. Un engin explosif improvisé (EEI), suivi d’une attaque au RPG, a tué cinq combattants des FDS et blessé un autre membre du convoi (welattv.net). Cela porte le nombre d’attaques de Daech contre les FDS à environ 185 depuis le début de 2025. Les FDS ont souligné que « la guerre contre Daech n’est pas terminée » et ont appelé à la poursuite du soutien dirigé par les États-Unis pour sécuriser des milliers de militants détenus et empêcher toute évasion.
Des escarmouches sporadiques ont persisté entre les FDS et les milices syriennes pro-turques le long des lignes de front. Le 10 septembre, la Brigade Suleiman Shah formée des Turkmènes et soutenue par la Turquie (désormais nominalement intégrée à la 62e division de l’armée syrienne) a échangé des tirs d’artillerie avec les FDS à Maskanah (campagne d’Alep), bien qu’aucune victime n’ait été signalée.
À la même période, les FDS et les nouvelles factions rebelles alignées sur le régime syrien se sont affrontées près des ponts à l’est de l’Euphrate. Le 20 septembre, de lourds bombardements autour de Deir Hafir (province d’Alep) par des forces affiliées au régime ont blessé au moins trois civils, selon l’OSDH. Quelques jours plus tard, des unités des FDS ont rapporté avoir déjoué une tentative d’« éléments dissidents » de l’armée syrienne de prendre le contrôle du district de Sheikh Maqsoud à Alep.
Entre-temps, les mouvements militaires turcs ont accru les tensions. Selon l’OSDH, le 27 septembre, les autoroutes entre Alep et Raqqa avaient été fermées par des milices soutenues par la Turquie, coïncidant avec l’entrée de convois militaires turcs dans les bases aériennes du nord. Les responsables turcs ont continué à émettre des avertissements : à la mi-septembre, le ministère turc de la Défense a accusé les FDS de ne pas avoir mis en œuvre l’accord d’intégration de mars et de saper « l’unité de la Syrie », et le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a menacé les forces kurdes.
Dans le canton d’Afrin, occupé par les forces turques et leurs milices alliées, les civils kurdes ont signalé des abus systématiques. Un centre de documentation basé en Syrie a signalé qu’au moins 14 Kurdes avaient été enlevés au début de septembre à Afrin et dans d’autres zones rebelles — faisant partie d’une vague plus large (environ 190 personnes depuis janvier) d’arrestations arbitraires et d’enlèvements de Kurdes par des groupes armés. Des témoins ont décrit des raids dans les maisons, des pillages et des détentions. En outre, de nouveaux décrets ont visé les droits de propriété des Kurdes. Le 18 septembre, l’administration d’Afrin, nommée par la Turquie, a publié la circulaire n°6, imposant des conditions onéreuses aux Kurdes déplacés souhaitant récupérer leurs terres ou logements. Le Conseil national kurde de Syrie (CNKS) a dénoncé ce décret comme « injuste », déclarant qu’il empêche effectivement les propriétaires légitimes de revenir. La règle oblige les requérants à naviguer dans une bureaucratie complexe, à payer des frais élevés et à prouver leur propriété, tout en omettant de sanctionner les occupants de leurs maisons. Les militants du CNKS ont noté que ces obstacles juridiques sont propres à Afrin et violent les droits des citoyens. Pour aggraver la situation, le 4 septembre, le ministère syrien de la Justice a transféré tous les juges kurdes restants des tribunaux d’Afrin, supprimant ainsi tout recours juridique local. Les groupes de défense des droits humains avertissent que ces politiques visent à consolider les changements démographiques et à empêcher le retour des Kurdes.
À noter qu’en septembre, la France a rapatrié 13 de ses ressortissants détenus dans le Camp de réfugiés d'Al-Hol sous contrôle kurde. Il s’agit de 3 femmes et 10 enfants. 47 autres détenus de nationalité française ont été transférés le 19 septembre en Irak, où ils doivent être jugés pour des crimes perpétrés sur le territoire irakien (Le Monde, 19 septembre).
À signaler aussi que la Syrie organisera le 5 octobre un scrutin indirect pour former un "Parlement transitoire" de 210 membres, dont un tiers nommé directement par le président intérimaire al-Charaa. Les deux provinces sous contrôle kurde et la province d’As-Suwayda, peuplée en majorité de Druzes, sont exclues de cet ersatz d’élections.
Le 5 septembre, la maire de Paris Anne Hidalgo a inauguré une allée des Peshmergas dans le parc Citroën du 15e arrondissement de Paris, en présence de l'ex-président du Kurdistan, Massoud Barzani, figure historique de la résistance kurde.
De nombreuses personnalités françaises, dont plusieurs adjoints à la maire, l'ex-ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, le philosophe Bernard-Henri Lévy, les maires des 15e et 10e arrondissements de Paris, étaient présents à cette cérémonie d'inauguration.
Plus de 300 ex-Peshmergas venant de plusieurs pays d'Europe, des représentants de la société civile kurde, de l’Institut kurde étaient présents à cette journée forte en émotion, qualifiée d'historique par le président Barzani qui a prononcé une brève allocution pour remercier la mairie de Paris pour cette marque de solidarité et de reconnaissance. Il a également remercié l’Institut kurde pour son rôle dans le développement des relations franco-kurdes, et la défense de la cause kurde, et la France pour son soutien constant au peuple kurde malgré les alternances politiques.
Il a rappelé que dans la lutte commune contre Daech, 12.000 Peshmergas ont été tués ou blessés, et que Daech a été vaincu grâce aux sacrifices des Peshmergas et des combattants kurdes syriens soutenus par la coalition internationale où la France joue, aux côtés des États-Unis, un rôle éminent.
« Donner à cette allée, située au bord de la Seine, tout près de la Tour Eiffel, le nom des Peshmergas est rendre hommage à tout ce que le peuple kurde et ses Peshmergas ont fait pour nous, pour notre liberté, pour la paix », a déclaré Mme Hidalgo dans son discours d’inauguration (voir notre site).
Une unité de Peshmergas, composée de femmes et d'hommes en uniforme, a été honorée par la maire de Paris.
De son côté, le maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, a fait l’éloge des Peshmergas, «une force de résistance du peuple kurde et un symbole de son combat continu depuis des générations pour la dignité, la liberté et le droit de vivre en paix ».
La présence kurde s’inscrit désormais dans la géographie parisienne. Après un jardin Yilmaz Güney et un parc Jina Mahsa Amini dans le 10e arrondissement, cette présence s’affirme désormais de façon durable dans le 15e arrondissement.
Récemment, une place Hevrin Khalaf, femme politique kurde, leader du Parti du Futur, assassinée par des milices islamistes pro-turques, avait été inaugurée à Lyon.