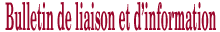Quelques jours après le rapport de l’Agence internationale de l’Énergie atomique (AIEA) affirmant que l’Iran disposait d’une quantité suffisante d’uranium enrichi pour fabriquer « plusieurs bombes », Israël a, le 13 juin, lancé une vaste offensive de bombardements aériens contre les sites nucléaires et les bases de lancement de missiles balistiques iraniens. Cette attaque massive semble avoir surpris le régime iranien qui, engagé dans d’interminables et dilatoires négociations avec les États-Unis, ne s’attendait pas à une offensive militaire unilatérale israélienne en plein processus de pourparlers, dont la prochaine session devait se tenir trois jours plus tard à Doha.
De son côté, l’État hébreu, qui se préparait depuis longtemps à une confrontation militaire avec la République islamique, affaiblie après l’effondrement de son « axe de résistance », a attendu le délai symbolique de « deux mois » fixé par Donald Trump pour la conclusion des « négociations de dernière chance ». C’est juste au lendemain de l’expiration de ce délai que l’aviation israélienne a lancé ses attaques contre des cibles militaires et civiles identifiées de longue date. Israël a assez rapidement pu réduire au silence ce qui restait de la défense anti-aérienne iranienne, s’assurer le contrôle de toute la partie occidentale et centrale du ciel iranien et bombarder à loisir ses objectifs.
Grâce à des renseignements précis obtenus par ses services, l’armée israélienne a tué une vingtaine de hauts responsables militaires et civils impliqués dans les programmes nucléaire et balistique iraniens. Une quinzaine de scientifiques et ingénieurs en charge de ces programmes ont également été assassinés. Outre les sites nucléaires d’Ispahan et de Natanz qui ont été dévastés, un réacteur de recherche à eau lourde, susceptible de produire potentiellement du plutonium mais qui n’était pas encore mis en service, a été détruit. Mais la centrale civile de Bouchehr, encore en construction par la Russie, n’a pas été attaquée.
Des casernes des Gardiens de la révolution susceptibles d’abriter des bases de lancement de missiles ont été bombardées et détruites sur une large partie du territoire, y compris au Kurdistan, notamment à Kermanshah. Des usines fabriquant des composants de centrifugeuses ou des missiles balistiques, ainsi que des installations industrielles considérées comme à usage dual, ont également subi des dégâts considérables. D’autres objectifs, perçus comme symboles de la dictature iranienne comme la télévision d’État et la terrible prison d’Evin à Téhéran, ont également été lourdement bombardés.
Le Premier ministre israélien aurait, selon les médias, prévu d’assassiner aussi l’ayatollah Khamenei, qui n’a eu de cesse de prôner la destruction d’Israël, mais il en aurait été empêché par Donald Trump, ce dernier ayant affirmé qu’il écartait « pour le moment » cette élimination pour éviter que l’Iran ne sombre dans le chaos – sans doute aussi pour garder un interlocuteur ayant suffisamment d’autorité pour imposer, le moment venu, un cessez-le-feu ou un accord de paix.
Le site nucléaire de Fordow, construit en profondeur dans la montagne et abritant, entre autres installations sensibles, des batteries de centrifugeuses de dernière génération pour l’enrichissement de l’uranium, n’a été affecté qu’à la surface par les bombardements israéliens.
Sous la pression de l’aile pro-israélienne de sa majorité et de Benjamin Netanyahu, le président américain, après avoir hésité quelques jours, a finalement décidé de "finir le job" en envoyant, dans la nuit du 20 au 21 juin, un groupe de bombardiers stratégiques B2 transportant chacun 2 bombes anti-bunker ultra puissantes GBU-57 pour détruire le site de Fordow.
Au total, en 25 minutes, 14 bombes – pesant chacune 13 600 kg – ont été larguées sur les sites de Fordow et de Natanz.
Un sous-marin de l’US Navy opérant dans le Golfe arabo-persique a, de son côté, lancé deux douzaines de missiles de croisière Tomahawk sur les sites nucléaires autour d’Ispahan.
Au total, cette opération Midnight Hammer a mobilisé 125 avions pour un coût total estimé à environ 1 milliard de dollars selon Dan Caine, chef d'état-major des armées des États-Unis (Le Figaro, 23 juin).
L’Iran a répliqué à cette opération américaine sans précédent en envoyant 14 missiles balistiques sur la base américaine du Qatar, tout en prenant la précaution d’avertir à l’avance les autorités qataries. Prévenue, l’armée américaine a pu évacuer la base et abattre sans problème les missiles iraniens qui n’ont donc fait aucune victime ni dégâts matériels.
Le président Donald Trump a remercié l’Iran d’avoir prévenu de sa réplique et sifflé la fin de la guerre de 12 jours, obligeant Israël et l’Iran à convenir d’un « cessez-le-feu complet et total » le 24 juin.
Il a félicité « Israël et l’Iran d’avoir eu l’endurance, le courage et l’intelligence de mettre fin à ce qui aurait pu être une guerre de plusieurs années capable de détruire l’ensemble du Moyen-Orient » (Euronews, 24 juin).
Au cours de ces 12 jours de guerre, l’Iran a répliqué aux attaques israéliennes en lançant de son côté plus d’un millier de missiles sur des cibles militaires et civiles israéliennes.
Le système de défense "Dôme de fer" a su neutraliser la très grande majorité de ces missiles, mais certains ont causé des dégâts importants sur une raffinerie de pétrole à Haïfa, sur des zones résidentielles de Tel Aviv et même sur un bâtiment du siège du Mossad. Au total, au moins 24 civiles ont été tués par des attaques de représailles iraniennes mais, semble-t-il, aucun espion du Mossad, car « ils étaient tous en Iran », selon les humoristes iraniens.
Côté iranien, le bilan officiel donné par l’agence de presse étatique IRNA est de 935 morts (Le Monde, 30 juin).
Quant au bilan des dégâts matériels considérables de cette guerre de 12 jours, il est impossible à établir. Selon le New York Times, la guerre aurait coûté à Israël environ 10 milliards de dollars.
L’Iran minimise ses pertes, son leader Ali Khamenei clame même la victoire contre Israël et les États-Unis (Le Monde, 27 juin).
Le bilan diplomatique est particulièrement désastreux pour l’Iran.
Au-delà des formules creuses et sans frais de condamnation des pays de la région, craignant une extension du conflit à l’ensemble de la région, ni la Russie, ni la Chine, clientes et « alliées » supposées de l’Iran, n’ont bougé le petit doigt.
Alliée habituel, la Syrie s’est réfugiée dans un mutisme le plus total, s’abstenant même d’émettre la moindre condamnation.
Autres alliés de "l’axe de la résistance" — conglomérat de milices chiites formées et armées à grands frais par la République islamique — ni le Hezbollah libanais, ni les milices chiites irakiennes ne sont venues au secours de Téhéran.
Les leaders des milices chiites irakiennes avaient gagné l’Iran dans la précipitation, craignant des opérations ciblées israéliennes ou des représailles massives américaines.
En Iran même, malgré l’appel au patriotisme, le régime, honni par la grande majorité des Iraniens, n’a pas réussi à rassembler autour de lui.
De peur de manifestations contre lui, le régime a coupé l’accès à l’Internet et aux réseaux sociaux, dont WhatsApp, accusés d’espionner pour le compte d’Israël (Le Monde, 20 juin).
Certains opposants connus, comme les lauréates du Prix Nobel de la Paix, Narges Mohammadi et Shirin Ebadi, ainsi que le cinéaste Jafar Panahi, dans une tribune publiée dans Le Monde du 16 juin, affirment que « la poursuite du programme nucléaire et la guerre entre la République islamique et le régime israélien ne servent pas les intérêts du peuple iranien ».
Les partis politiques kurdes ont imputé la responsabilité de la guerre au régime iranien, qui gaspille les ressources du pays dans des ruineux programmes nucléaires et balistiques et dans le financement des milices chiites qui menacent et déstabilisent l’ensemble de la région.
Pour eux, il n’y aura ni paix ni stabilité régionale tant que la République islamique accapare le pouvoir à Téhéran.
La question de la menace nucléaire iranienne divise les experts.
Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, les bombardements israéliens et américains ont causé des dégâts considérables dans les principaux sites nucléaires iraniens connus, mais on ne sait pas où se trouve le stock de plus de 400 kg d’uranium enrichi à 60 %, qui a peut-être été évacué vers un lieu inconnu.
En ce cas, la guerre n’aurait retardé que de « six mois » le programme nucléaire en cours.
Les premières évaluations des agences américaines d’espionnage vont dans le même sens.
Mais le président américain affirme que les installations nucléaires iraniennes, y compris Fordow, ont été « anéanties pour toujours » et que l’Iran n’accédera jamais à la bombe.
De son côté, Israël affirme avoir retardé de « plusieurs années » le programme nucléaire iranien et dévasté en grande partie ses sites balistiques.
« Même si le stock d’uranium enrichi était préservé, les scientifiques et ingénieurs qui pouvaient en faire des bombes ont été éliminés », a déclaré un haut responsable israélien.
Au sein du régime iranien, les pragmatiques regroupés autour du président Massoud Pezechkian seraient prêts à mettre en sourdine ce programme nucléaire, source de tant de malheurs, afin d’obtenir la levée progressive des sanctions qui frappent durement l’économie du pays.
Cependant, la ligne dure incarnée par l’ayatollah Khamenei et certains chefs des Gardiens de la Révolution rejette tout accord mettant en cause le programme d’enrichissement de l’uranium qui, au-delà d’un seuil de 3,5 %, ne peut avoir qu’une finalité militaire.
En attendant l’issue de cette épreuve de force discrète, le régime accentue la répression des opposants réels ou supposés en les accusant d’être des agents d’Israël.
Selon une enquête du New York Times du 28 juin, cette chasse aux ennemis de l’intérieur a déjà abouti à l’arrestation de plusieurs centaines de personnes.
À défaut d’identifier ceux qui, depuis l’Iran, ont aidé les services israéliens à rassembler sur place des missiles et des milliers de drones miniatures à Téhéran et dans ses alentours, le régime s’en prend à des réfugiés afghans sans papiers et à des civils kurdes et baloutches.
Ainsi, en quelques semaines, plus de 400 000 Afghans ont été expulsés manu militari vers l’Afghanistan.
Le 25 juin, 3 prisonniers kurdes, Idris Ali, Azad Shojai de Sardasht, Rasoul Ahmad de Souleimaniyeh, ont été secrètement exécutés dans la prison d’Ourmia. Les trois hommes étaient détenus depuis juillet 2023 et étaient accusés d’espionnage au profit d’Israël.
Avant même la guerre de 12 jours, le régime iranien avait, en mai 2025, exécuté 163 personnes dont 26 Kurdes, selon un décompte établi par l’ONG Hengaw.
5 femmes, 3 enfants, 3 écrivains figuraient parmi les suppliciés.
Un bilan établi au 29 juin par Hengaw fait état de plus de 300 Kurdes arrêtés en juin par les forces de répression iraniennes.
Parmi eux, une personne est morte sous la torture, un enfant et un homme ont été tués
Et trois prisonniers kurdes ont été exécutés. Parmi les personnes arrêtées, 18 filles de moins de 18 ans à Mahabad et 6 femmes à Qasr-e Chirin, Le Kurdistan est quadrillé et militarisé partout.
La répression est massive à Téhéran aussi où plus d’un millier de personnes ont été arrêtées en juin.
Le Parti républicain du peuple (CHP), fondé par Atatürk en 1923, nationaliste et laïc, est désormais l'adversaire à abattre, du moins à affaiblir, du pouvoir turc. Tous les moyens d'une justice instrumentalisée et aux ordres sont mobilisés pour déstabiliser, discréditer et décapiter cette principale force de l'opposition qui représente une menace réelle pour la pérennité du pouvoir du président Erdoğan. Le parti a pu, avec le soutien du parti pro-kurde DEM, emporter les mairies lors des élections municipales de mars 2024, dans les principales métropoles turques dont Istanbul, Ankara, Izmir et Adana, infligeant une sévère défaite à la coalition gouvernementale AKP-MHP. Une humiliation pour le président turc qui, depuis, met en œuvre une stratégie de revanche qui comprend des volets judiciaires et politiques.
Sur le plan judiciaire, un ancien vice-ministre AKP de la Justice, nommé procureur général d’Istanbul a pu, sous des prétextes fallacieux, faire arrêter le maire élu et très populaire d’Istanbul Ekrem Imamoglu et une centaine d’élus municipaux. Ils sont accusés, par des « témoins secrets », de corruption et embastillés avant même le début d’un procès. Dans une démocratie digne de ce nom, après l’enquête de police, si des éléments sérieux sont avérés, ils seraient poursuivis et jugés lors d’un procès public et contradictoire. Un éventuel premier jugement en première instance ferait l’objet d’un appel puis, si nécessaire, d’un recours devant la cour de cassation. Ce n’est que lorsque celle-ci aurait rendu un arrêt définitif que les accusés seraient incarcérés et déchus de leur mandat. En Turquie, on arrête d’abord qui on veut, même élus, députés, journalistes ou avocats, on l’incarcère et on charge l’appareil judiciaire de prouver sa culpabilité au bout de procès qui peuvent durer des années.
Ainsi, l’ancien co-président du Parti de l’égalité des peuples, rebaptisé récemment DEM, Selahattin Demirtaş, à deux reprises candidat à la présidence de la République contre Erdoğan, a été arrêté en 2016 et depuis ses procès se poursuivent. Il a déjà été condamné à 42 ans de prison pour ses discours et ses écrits et malgré plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme exigeant sa libération immédiate, il est toujours derrière les barreaux, tout comme le mécène turc Osman Kavala, condamné à perpétuité pour son soutien au mouvement de contestation pour la préservation du parc Gezi d’Istanbul, en 2013, menacé par les projets immobiliers du président Erdoğan.
Le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, poursuivi dans une dizaine de procès, a comparu le 16 juin devant un tribunal siégeant dans l’immense centre carcéral de Silivri, le plus grand pénitencier d’Europe. Il a expliqué qu’il ne subissait « pas un procès, mais une punition judiciaire » (Le Monde, 16 juin). Son propre avocat, qui contestait la légalité d’un procès sur la seule base de témoins secrets, a été arrêté quatre jours plus tard. Quelques jours plus tard, le 21 juin, Fatih Altaylı, ex-présentateur vedette de télévision, proche du CHP, était arrêté pour « mensonges envers le président ». Il avait publié le 20 juin une vidéo sur sa chaîne YouTube commentant un sondage selon lequel 70% des Turcs s’opposeraient à une présidence à vie d’Erdoğan. Impardonnable crime de lèse-majesté ! La veille, un procureur avait exigé la condamnation du journaliste Furkan Karabay, détenu depuis le 15 mai, pour trois tweets, accusé d’avoir « dépassé le cadre de la liberté d’expression », rapporte Le Monde, qui ajoute que le même jour a eu lieu la cinquième audience du procès intenté à un autre journaliste, Barış Pehlivan, pour "insulte publique à un fonctionnaire". Une journaliste et autrice de BD franco-kurde, Kudret Günes, 69 ans, arrêtée à son arrivée à Istanbul le 27 mai, est depuis placée en résidence surveillée. Elle doit comparaître le 8 juillet devant un tribunal.
Dans son enquête intitulée « En Turquie, la chronique impossible d’une justice instrumentalisée », parue dans Le Monde du 26 juin, Nicolas Bourcier relève « le recours fréquent à des articles de loi à l’interprétation beaucoup trop large, comme 'insulte au président' ou 'appartenance à une organisation terroriste' ». La Turquie détient le record mondial d’inculpation pour terrorisme. Il souligne aussi « l’opacité du système judiciaire (audiences parfois à huis clos, censure, recours immodéré aux témoins secrets), la forte judiciarisation du journalisme (poursuites pour diffamation, terrorisme, atteinte à l’État) et le manque de protection de la liberté de la presse ».
Cette répression tous azimuts, qui frappe pêle-mêle militants, écrivains, avocats, artistes, membres de la communauté LGBT, Kurdes de tout bord, se focalise ces derniers temps sur le CHP qui fait face à un procès où la légalité de son dernier congrès est contestée, toujours sur la base des plaintes de « témoins secrets ». Si le tribunal dénie la légalité du congrès et des organes qui y ont été élus, le gouvernement pourrait nommer un administrateur judiciaire à la tête du parti et faire condamner son actuel leader Özgür Özel, principal opposant d’Erdoğan, qui par ailleurs est poursuivi dans une kyrielle de procès pour « insulte au président », « discrédit de la justice », « diffamation du procureur général ». Décapiter le CHP lui ouvrirait la voie à une réélection plus aisée, s’il s’assure de la neutralité du parti pro-kurde DEM. Car sans le soutien explicite ou tacite de DEM, le CHP ne peut gagner ni les élections municipales ni les élections législatives et présidentielles.
Le président turc, qui depuis son arrivée au pouvoir en 2003, a toujours su conclure des alliances de circonstance, tantôt avec les libéraux turcs opposés à la mainmise des militaires, tantôt aux islamistes de Fethullah Gülen (devenus ensuite ses pires ennemis), tantôt avec les ultranationalistes du MHP, courtise ces derniers mois, le parti pro-kurde DEM en miroitant de possibles concessions au terme d’un processus de paix pour le moins opaque. Certaines réformes, dont on ignore le contenu, seraient promises en contrepartie de l’auto-dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), à la faveur de sa trêve armée. Le 26 juin, un porte-parole de DEM a annoncé que le processus en cours entre Ankara et le PKK a atteint « une étape importante ». Une délégation de ce parti poursuit ses rencontres avec le chef du PKK Abdullah Öcalan, incarcéré sur l’île-prison d’Imrali depuis 26 ans, et les divers partis politiques turcs. Un groupe de combattants du PKK pourrait, en juillet, déposer les armes en un lieu non précisé au Kurdistan irakien, en geste de bonne volonté. De son côté, une commission parlementaire ad hoc chargée du suivi de ce processus pourrait être mise en place en juillet aussi.
En attendant l’issue de ce processus qui pourrait prendre encore des mois et occuper le parti DEM dans son dialogue avec le pouvoir, celui-ci aura les mains libres pour concentrer ses efforts afin de déstabiliser et décapiter un CHP politiquement isolé, qui ne cesse d’appeler à des élections anticipées dans l’espoir de vaincre dans les urnes et briser le carcan judiciaire qui risque de l’étouffer.
La guerre israélo-iranienne a eu un impact limité au Kurdistan irakien. L’espace aérien a été fermé pendant deux semaines et les vols suspendus. Dès le début du conflit, le gouvernement du Kurdistan a appelé au dialogue et le président Barzani a assuré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghtchi que le territoire kurde ne servirait pas de base à des attaques contre l’Iran.
De leur côté, les milices chiites irakiennes pro-iraniennes, craignant des représailles américaines massives, n’ont lancé aucun drone ni missile contre des cibles au Kurdistan, ni contre des bases américaines en Irak. Des voyageurs bloqués par la suspension des vols ont pu poursuivre leur voyage en regagnant par la route la Turquie où les liaisons aériennes fonctionnaient normalement.
L’impact économique de la guerre a été relativement important en raison de la fermeture des frontières avec l’Iran et de l’arrêt des échanges pendant plusieurs semaines. Mais c’est surtout le non-versement par Bagdad des salaires et des pensions des fonctionnaires, des employés et des retraités kurdes qui a provoqué une nouvelle crise financière.
Malgré les accords conclus lors de la formation de l’actuelle coalition gouvernementale irakienne, malgré les dispositions constitutionnelles attribuant une dotation financière représentant environ 12,5 % du budget fédéral, le gouvernement de Bagdad n’honore pas ses engagements et prive à nouveau le Kurdistan de ressources budgétaires. Le 2 juin, le comité central du Parti démocratique du Kurdistan a déclaré dans un communiqué que "certains dirigeants de l’Irak d’après 2003 possèdent une mentalité très éloignée du fédéralisme et montrent des tendances vers une restauration du contrôle centralisé étatique". La déclaration les accuse d’utiliser le non-paiement des salaires des fonctionnaires et des allocations budgétaires à la Région du Kurdistan comme moyen de pression sur Erbil.
Dans une lettre adressée, le 28 mai, au Gouvernement régional du Kurdistan, le ministère irakien des Finances signifiait que le gouvernement avait décidé d’arrêter tout transfert budgétaire au KRG, y compris les salaires de plus d’un million d’employés du secteur public. Selon le ministre Taif Sami Mohammed, Erbil aurait déjà reçu sa part de 12,67 % du budget fédéral, soit 13,547 trillions de dinars irakiens (environ 10,34 milliards de dollars).
Version contestée par les dirigeants kurdes qui ont enjoint le gouvernement fédéral de verser les salaires dus avant l’Eid al-Adha, le 6 juin. Un groupe de fonctionnaires kurdes a saisi la Cour fédérale suprême pour qu’elle ordonne au gouvernement fédéral de verser leurs salaires. Cette cour, dans un arrêt de février 2023, avait explicitement décidé que les disputes sur les revenus pétroliers et non pétroliers entre Bagdad et Erbil ne doivent pas être utilisées comme base pour retenir des salaires mensuels garantis par la Constitution (Rudaw, 2 juin). Le leader du PDK et ancien président Massoud Barzani a rappelé à cette occasion que l’Irak post-Saddam était fondé sur les principes d’équilibre, de compromis et de partenariat dans le cadre de la Constitution. La seule voie pour résoudre les problèmes de l’Irak est l’adhésion à ces principes par toutes les parties (Rudaw, 2 juin).
Le 16 juin, le Premier ministre du Kurdistan a envoyé une lettre à la Cour fédérale suprême, arguant de "l’illégalité et de l’inconstitutionnalité de la décision du ministère fédéral des Finances de suspendre les salaires et les dotations financières de la Région du Kurdistan". Il a émis l’espoir que la Cour fédérale rendra "une décision positive en faveur du peuple du Kurdistan", ajoutant que son gouvernement avait rempli "toutes ses obligations et demandes constitutionnelles".
De son côté, le président de la République d’Irak, Abdul Latif Rashid, a rencontré le 16 juin à Bagdad le chef de la Cour suprême fédérale Jassim al-Umairi pour lui rappeler l’importance de régler la question des salaires du secteur public du Kurdistan. Le président de la Cour s’est dit d’accord pour que cette affaire soit examinée le plus tôt possible par la Cour fédérale, selon Hawre Tofiq, un porte-parole de la présidence irakienne (Rudaw, 16 juin).
En attendant, l’économie du Kurdistan tourne au ralenti et dans cette atmosphère de crise, le dialogue entre les partis politiques kurdes se renforce, mais la formation d’un nouveau gouvernement de coalition se fait toujours attendre.
Après des mois de tergiversations, Washing¬ton a donné son aval pour l'intégration des milliers d'ex-djihadistes étrangers dans l'armée syrienne. C'est l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Thomas Barrack, égale¬ment ambassadeur en poste à Ankara, qui l'a annoncé le 3 juin à l'agence britannique Reuters (Le Monde, 3 juin). Estimant qu'il est préférable de garder les combattants au sein d'un projet d'État plutôt que de les exclure au risque de les voir se disperser dans la nature, l'ambassadeur Barrack affirme par ailleurs que beaucoup de ces étrangers sont « très loyaux » envers la nouvelle administration syrienne.
Selon Le Monde, ces ex-djihadistes seraient « au nombre de plusieurs milliers », dont quel¬ques dizaines de Français. Leur plus gros contingent est issu du Parti islamique du Turkestan (PIT). Ce parti, regroupant des djihadistes ouïgours originaires de Chine, a été fondé en 1997 au Pakistan et ses membres ont développé des liens étroits avec al-Qaida, avant de venir combattre dans les rangs du Front al-Nosra, branche syrienne d'al-Qaida, dirigée par l'actuel président syrien al-Charaa.
On compte aussi de nombreux djihadistes de Russie (Tchétchénie, Daghestan), d’Égypte, d’Iran, d’Afrique du Nord (New York Times du 8 juin). Une véritable internationale djihadiste qui va désormais former officiellement, aux côtés de ses alliés du HTC du président al-Charaa, lui-même ex-djihadiste, le noyau structurant de la nouvelle armée syrienne. Six de leurs commandants avaient été promus généraux de brigade dès décembre 2024.
C'est sur une telle armée islamiste que compte Washington et ses alliés arabes et turcs pour rétablir l'ordre dans la "transparence". Or, comme lors du massacre d’alaouites en mars dernier qui ont fait 1.700 morts, leur haine de tout ce qui n’est pas musulman arabe sunnite les pousse à exécuter froidement des civils ala¬ouites ou druzes.
Malgré la promesse du président syrien de créer une com¬mission d’enquête pour identifier et punir les auteurs de ces massacres, nul n’a été inquiété depuis. Les exactions sont devenues routinières. Le 4 juin, huit alaouites ont été tués par balles à un poste de contrôle des forces de sécurité dans la province de Hama, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Le Monde souligne que la minorité alaouite, dont est issu l'ex-président Bachar al-Assad, subit des violences depuis la prise de pouvoir par la coalition conduite par Ahmed al-Charaa (Le Monde, 4 juin).
Parmi ces violences, les enlèvements de femmes alaouites qui, selon une enquête publiée dans Le Figaro du 25 juin, se multiplient et font l’objet de trafics entre islamistes.
Malgré les promesses réitérées du nouveau régime, la minorité chrétienne du pays reste extrêmement vulnérable. Un attentat-suicide contre une église de Damas, le 22 juin, a fait 25 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont imputé cet attentat à l'État isla¬mique tandis que, le 24 juin, un groupe djihadiste peu connu, Saraya Ansar al-Sunna, a revendiqué cet « acte de djihad contre les mécréants ».
Le ministère de l’Intérieur a de son côté affirmé que ce groupe était certainement affilié à l’État Islamique et que l’auteur de l’attentat ne serait pas syrien, mais un djihadiste venant du camp d’al-Hol, sans apporter la moindre preuve.
Lors des funérailles de neuf des victimes organisées dans l’église de la Sainte-Croix de Damas, le patriarche grec orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, Yohanna X, a fustigé un "massacre inacceptable" et critiqué les autorités, les appelant à « assumer leurs responsabilités ».
"Le crime odieux qui s’est produit à l’église Sainte-Croix est le premier massacre en Syrie depuis les événements de 1860", a-t-il déclaré en référence aux massacres de chrétiens de Damas sous l’Empire ottoman (Le Monde, 24 juin).
Pressé de se retirer à temps du chaos syrien qui se profile, Washington pousse les forces kurdes à "intégrer" les institu¬tions de cet État islamique autoritaire et centralisateur qui rejette toute idée de décentralisation, de reconnaissance d’un minimum d’autonomie aux diverses composantes de la mosaïque syrienne.
Dans une déclaration à la chaîne d’infos turque NTV le 4 juin, l’envoyé spécial américain pour la Syrie a annoncé le retrait progressif du dispositif militaire américain du nord-est de la Syrie. "La réduction de notre mission Inherent Resolve est en cours. Nous passerons de huit à cinq points et trois bases. Et nous finirons avec une".
Les autorités américaines estiment avoir mené avec succès leur lutte contre le groupe État Islamique, bien que des cellules djihadistes demeurent actives sur le terri¬toire syrien en pleine transition politique. (Le Figaro, 8 juin)
Le 8 juin, l’ensemble des partis politiques kurdes de Syrie ont formé une délégation commune chargée de négocier avec Damas les revendications kurdes formulées lors du Congrès national kurde d’avril dernier.
La délégation, qui s’est réunie en présence du général Mazlum Abdi, commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), est composée des membres du Parti de l’unité kurde (PYD) et de ceux de la coalition d’opposition Congrès national kurde. Elle est co-présidée par Perwin Yousef, co-présidente du PYD, et le président du Conseil national kurde, Mohammed Ismaël. Elle doit se rendre à Damas "dès que possible".
Les décisions prises lors de la rencontre entre Mazlum Abdi et le président par intérim al-Charaa en mars dernier peinent à être appliquées, notamment dans le domaine du retour des déplacés kurdes vers les territoires occupés par les milices pro-turques.
Le Monde, dans son édition du 18 juin, a publié une vaste enquête sur "le difficile retour des Kurdes soumis à la loi des milices financées par la Turquie".
« Nous vivons encore sous occupation, nous subissons toujours des extorsions et des intimidations de milices », déclarent les habitants d’Afrin interrogés par Le Monde.
Le nouveau régime veut ménager son puissant allié turc, force d’occupation, souligne le journaliste, qui relate la mainmise persistante sur ces territoires des milices de l’Armée nationale syrienne (ANS), comptant quelque 15 000 hommes armés et financés par la Turquie.
Ailleurs en Syrie arabe, plus de deux millions de déplacés sont rentrés chez eux depuis la chute de Bachar al-Assad selon l’ONU (RF, 19 juin).