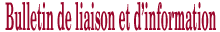À l'appel de son leader emprisonné Abdullah Öcalan, le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a réuni dans les maquis du Kurdistan irakien son 12e Congrès qui s'est déroulé du 5 au 7 mai avec la participation de 232 délégués. Le Congrès a décidé de dissoudre "la structure organisationnelle du PKK" et de mettre un terme à la lutte armée menée depuis 1984. Cette insurrection kurde, qui fut la plus longue de l'histoire de la République turque, a provoqué la mort de 40.000 à 100.000 personnes selon les estimations, le chiffre de 100.000 étant avancé récemment par l'ancien vice-Premier ministre turc Bülent Arınç lors d’un colloque à Erbil. Les victimes sont à plus de 90 % des Kurdes, pour la plupart des civils, y compris des milliers d'intellectuels, syndicalistes, étudiants, médecins et avocats assassinés par les escadrons de la mort de la gendarmerie turque (JITEM) durant la "sale guerre" de 1992-1996 dans ce que le New York Times avait qualifié de "Kurdish killing fields" et les ONG locales de "meurtres inconnus" (faili meçhul). À ce bilan humain, il faut ajouter la dévastation du pays kurde avec la destruction de 3.400 villages et de l'économie agro-pastorale traditionnelle, et les déplacements forcés de 2 à 3 millions de paysans kurdes pour priver la guérilla de moindres soutiens dans les campagnes. Le coût pour l’État turc, en termes financiers, a été récemment évalué à plus de 2.000 milliards de dollars par le président turc et par son ministre des Finances, Mehmet SIMSEK.
Le PKK, qui dans la période consécutive au coup d'État militaire turc de septembre 1980, extrêmement répressive, a mobilisé ses militants pour la création d’un Kurdistan uni et socialiste, a, au fil des ans et de l’évolution de son idéologie, modifié radicalement ses objectifs. Depuis l’arrestation de son leader Öcalan en 1999 et à l’appel de celui-ci, le PKK ne revendique plus qu’une vague "autonomie démocratique" au contenu et aux contours des plus imprécis. Ces dernières années, le mot "autonomie" a lui-même été abandonné au profit d’une "Turquie démocratique", sans revendication principale pour les quelque 26 millions de Kurdes de ce pays. L’heure est, selon le communiqué final du congrès (voir ci-dessus), à la paix, à la fraternité à la poursuite du combat pour les droits démocratiques, un combat pacifique qui requiert l’abandon de la lutte armée.
Ce tournant qualifié d’historique par les médias (voir revues de presse du 24-25, 31, 104) a été salué par le président turc, pour qui il s’agit d’une "décision importante pour le maintien de la paix et de la fraternité". "Nous avançons avec confiance vers notre objectif d’un avenir sans terreur, surmontant les obstacles, en brisant les préjugés et en déjouant les pièges de la discorde". La décision d’autodissolution du PKK a également été saluée par les chancelleries occidentales ainsi que par les autorités du Gouvernement régional du Kurdistan.
En contrepartie de l’annonce de l’abandon de la lutte armée, le PKK n’a obtenu aucun engagement public du gouvernement turc, pas même une promesse d’amnistie, même si Ankara laisse entrevoir l’espoir de "gestes" ultérieurs après le dépôt des armes. La délégation du parti pro-kurde DEM, qui fait la navette entre İmralı (prison où est détenu Öcalan) et les partis politiques turcs, continue ses efforts de préparation de l’opinion publique turque et kurde en émettant des vœux de réconciliation, de "fraternité", sans contenu précis. Le décès de l’une des figures de cette délégation, Sırrı Süreyya Önder, député d’origine turque d’Istanbul et l’un des vice-présidents du Parlement turc, le 3 mai, a suscité une sorte de communion autour de lui, réunissant pour un moment de commémoration la plupart des responsables politiques kurdes et turcs à Istanbul (AFP, 3 mai). Ses funérailles ont été transmises en direct par certaines chaînes de télévision locales.
Par ailleurs, le 8 mai, le Parlement européen réuni à Strasbourg a approuvé par 367 voix pour, 74 contre et 188 abstentions, le rapport sur la Turquie de l’eurodéputé espagnol Nacho Sánchez Amor qui estime que "au vu du recul démocratique en cours en Turquie, le processus d’adhésion à l’Union européenne ne peut être relancé". Les eurodéputés privilégient le développement de partenariats stratégiques avec Ankara (Euronews, 8 mai).
À titre d'information, voici une traduction en français du texte intégral de la déclaration finale du 12e Congrès du PKK, à partir du texte original diffusé par l’agence officieuse du PKK, ANF, le 12 mai.
« Le processus entamé par la déclaration du dirigeant Abdullah Öcalan en date du 27 février s’est conclu avec succès lors de notre 12e Congrès du Parti, tenu du 5 au 7 mai, à la lumière des travaux multiples qu’il a menés et des différentes perspectives qu’il a offertes.
Malgré les conditions difficiles — la poursuite des affrontements, les attaques terrestres et aériennes, le siège sur nos zones et l’embargo du PDK — notre congrès s’est tenu en toute sécurité. Pour des raisons de sécurité, il a été organisé simultanément dans deux zones différentes. Réuni avec la participation de 232 délégués, le 12e Congrès du PKK a débattu des thèmes suivants : le Leadership, les Martyrs, les Blessés, l’Existence Organisationnelle du PKK et la Lutte Armée, ainsi que la Construction d’une Société Démocratique. Il a adopté des décisions historiques ouvrant une nouvelle phase pour notre Mouvement de Liberté.**
Le 12e Congrès extraordinaire du PKK a estimé que la lutte menée par le PKK avait brisé la politique de négation et d’anéantissement contre notre peuple, et permis d’approcher une résolution de la question kurde par la voie politique démocratique, accomplissant ainsi sa mission historique. Sur cette base, le 12e Congrès du PKK a décidé, sous la direction d’Öcalan, de dissoudre la structure organisationnelle du PKK et de mettre fin à la lutte armée, mettant ainsi un terme aux activités menées sous le nom de PKK.
Notre Parti, le PKK, est apparu sur la scène historique en tant que mouvement de liberté de notre peuple, en réaction à la politique de négation et d’anéantissement des Kurdes, héritée du Traité de Lausanne et de la Constitution de 1924. À sa naissance, il a été influencé par le socialisme réel et a adopté la stratégie de lutte armée sur la base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le PKK s’est formé dans un contexte marqué par une négation rigide des Kurdes, des politiques d’anéantissement, de génocide et d’assimilation. À partir de 1978, avec sa lutte pour la liberté, il a imposé la reconnaissance de l’existence kurde et inscrit la question kurde comme une réalité fondamentale de la Turquie. Grâce à sa lutte réussie, il est devenu un symbole d’espoir pour la liberté et de quête d’une vie digne pour les peuples de la région.
Dans les années 1990, époque où notre révolution de résurrection a entraîné de grands progrès pour notre peuple, le président de la République turque Turgut Özal a tenté de résoudre la question kurde par des moyens politiques. Le leader Öcalan a répondu à cette initiative par une trêve annoncée le 17 mars 1993, amorçant un nouveau processus. Mais l’influence lourde du socialisme réel, les courants mafieux imposés à notre ligne de guerre, et l’élimination par l’État profond de Turgut Özal et de son entourage, ont conduit à l’échec de cette nouvelle phase, tandis que la politique de négation et d’anéantissement s’intensifiait. Des milliers de villages furent brûlés, des millions de Kurdes déplacés, des dizaines de milliers emprisonnés sous la torture, et des milliers assassinés de manière extrajudiciaire. Face à cela, le Mouvement de Liberté s’est renforcé tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; la guerre de guérilla s’est étendue au Kurdistan et à la Turquie. Sous l’effet de cette guerre, le peuple kurde s’est soulevé. Ainsi, la guerre est devenue l’option principale pour les deux camps. L’escalade mutuelle du conflit n’a jamais pu être dépassée. Les efforts du dirigeant Öcalan pour résoudre pacifiquement la question kurde ont échoué.
Avec le complot international du 15 février 1999, le processus a franchi une nouvelle étape. Ce complot visait notamment à déclencher une guerre kurdo-turque, mais celle-ci a été empêchée grâce aux sacrifices et efforts d’Öcalan. Bien qu’il soit détenu dans le système de torture et de génocide d’Imralı, il a maintenu son insistance pour une solution démocratique et pacifique à la question kurde. Depuis 27 ans, en régime d’isolement absolu, Öcalan lutte contre le système de génocide d’Imralı et a ainsi déjoué le complot international. Dans cette lutte, il a développé un paradigme sociétal démocratique, écologique et basé sur la libération des femmes, en analysant le système patriarcal, étatique et autoritaire. Il a concrétisé une alternative de liberté pour notre peuple, les femmes et l’humanité opprimée.
Se référant à la période antérieure au Traité de Lausanne et à la Constitution de 1924, période de rupture des relations kurdes-turques, Öcalan a adopté la perspective d’une République Démocratique de Turquie fondée sur une Patrie Commune et une Nation Démocratique, reconnaissant les peuples kurde et turc comme éléments fondateurs. Les révoltes kurdes, le lien historique de mille ans entre Kurdes et Turcs, et les 52 ans de lutte d’Öcalan montrent que la seule solution viable passe par la Patrie Commune et une Citoyenneté Égalitaire. Les récents développements au Moyen-Orient dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale rendent inévitable une réorganisation des relations kurdo-turques.
Depuis 52 ans, en rejoignant la marche du Leader et du PKK au prix de grands sacrifices, notre peuple digne, qui a résisté à la politique de négation, d’anéantissement, de génocide et d’assimilation, embrassera le processus de paix et de société démocratique avec plus de conscience et d’organisation. Nous avons la conviction que notre peuple comprendra mieux que quiconque la décision de dissoudre le PKK et de mettre fin à la lutte armée, et qu’il assumera les devoirs de l’ère de la lutte démocratique pour la construction d’une société démocratique. Il est vital que notre peuple, sous la direction des femmes et des jeunes, crée ses propres structures dans tous les domaines de la vie, s’organise sur la base de l’autosuffisance avec sa langue, son identité et sa culture, se défende face aux attaques, et construise une société démocratique communale dans un esprit de mobilisation. Dans ce cadre, nous croyons que les partis politiques kurdes, les organisations démocratiques, les leaders d’opinion assumeront leurs responsabilités pour développer la démocratie kurde et la nation démocratique kurde.
L’héritage de notre histoire de liberté forgée par la lutte et la résistance se développera plus fortement par la voie de la politique démocratique, conformément aux décisions du 12e Congrès du PKK, et l’avenir de nos peuples progressera sur les bases de la liberté et de l’égalité. Nos peuples pauvres et laborieux, tous les groupes de croyance, les femmes, les jeunes, les ouvriers, les paysans, ainsi que toutes les composantes exclues du pouvoir, développeront une vie commune dans un environnement démocratique et juste en défendant leurs droits.
La décision prise par notre congrès de dissoudre le PKK et de mettre fin à la lutte armée constitue une base solide pour une paix durable et une solution démocratique. La mise en œuvre de ces décisions nécessite la direction et la gestion du processus par Öcalan, la reconnaissance du droit à l’action politique démocratique, et une garantie juridique solide et cohérente. À ce stade, il est crucial que la Grande Assemblée nationale de Turquie assume sa responsabilité historique. De même, nous appelons tous les partis politiques représentés au Parlement, en particulier le gouvernement et le principal parti d’opposition, les organisations de la société civile, les communautés religieuses et de foi, les médias démocratiques, les leaders d’opinion, les intellectuels, les universitaires, les artistes, les syndicats ouvriers et paysans, les organisations de femmes et de jeunesse, et les mouvements écologistes à prendre leurs responsabilités et à participer au processus de paix et de société démocratique.
L’appropriation du processus par les forces de gauche-socialistes de Turquie, les structures révolutionnaires, les organisations et les figures engagées donnera une nouvelle dimension à la lutte des peuples, des femmes et des opprimés. Cela reviendra à accomplir les objectifs des grands révolutionnaires dont les derniers mots furent : “Vive la fraternité des peuples turc et kurde et la Turquie pleinement indépendante !”
Le socialisme de société démocratique, représentant une nouvelle étape du processus de paix, de société démocratique et de lutte pour le socialisme, fera progresser le mouvement démocratique mondial vers un monde juste et égalitaire. Dans ce cadre, nous appelons nos amis, notamment ceux qui ont dirigé la Campagne Mondiale pour la Liberté, ainsi que l’opinion démocratique internationale, à renforcer la solidarité internationale dans le cadre de la théorie de la modernité démocratique.
Nous appelons les puissances internationales à reconnaître leur responsabilité dans les politiques de génocide centenaire menées contre notre peuple, à ne pas faire obstacle à une solution démocratique, et à y contribuer de manière constructive.
Notre 12e Congrès du PKK, réuni à l’appel de notre Leader, a annoncé la mort de deux cadres dirigeants du Parti : Fuat-ALI HAYDAR KAYTAN, tombé en martyr le 3 juillet 2018, et RIZA ALTUN, tombé le 25 septembre 2019. Sur cette base, le camarade fondateur du PKK, Fuat-ALI HAYDAR KAYTAN, a été reconnu comme le symbole de la “Fidélité au Leader, de la Vérité et de la Vie Sacrée”, tandis que RIZA ALTUN, l’un des premiers compagnons d’Öcalan, a été reconnu comme le symbole de la “Camaraderie de la Liberté”. Nous dédions notre 12e Congrès du Parti à ces deux grands camarades martyrs qui, depuis le début de notre Mouvement de Liberté, nous ont guidés sans relâche par leur combat. Nous renouvelons, en leur nom et au nom de tous les martyrs de la lutte, notre promesse de réussite, et affirmons notre engagement à réaliser les rêves du Martyr de la Paix et de la Démocratie, de camarade Sırrı Süreyya Önder.
Le socialisme étatiste-national perd ; le Socialisme de Société Démocratique mène à la victoire !
L’insistance pour l’humanité est l’insistance pour le socialisme !
Bijî Serok Apo !
Le nouveau régime syrien, soutenu par l'Arabie Saoudite et la Turquie, a fait une percée diplomatique remarquable en pour sa légitimité internationale.
Le 7 mai, le président par intérim Ahmed al-Charaa a été reçu au Palais de l'Élysée par le Président Emmanuel Macron. Cette première visite du dirigeant syrien dans une capitale occidentale a été saluée comme un succès majeur pour un ancien chef djihadiste dont la tête était mise à prix il y a encore quelques mois par les services américains.
Au cours de cette visite, le président français a promis d'intervenir auprès de l'Union européenne pour la levée des sanctions frappant la Syrie. Il lui a demandé de veiller à ce que le processus de transition en cours inclue toutes les composantes de la société syrienne, dans le respect de leur identité et de leur diversité. La France tient en particulier à la bonne intégration de ses alliés kurdes dans les institutions de la nouvelle Syrie.
Le 14 mai, le président américain Donald Trump, en visite officielle en Arabie Saoudite, a consenti, à la demande du prince héritier Mohammed bin Salman, à rencontrer "brièvement" al-Charaa à Ryad. L’entretien auquel a également assisté le prince héritier et, par visioconférence, le président turc Erdogan a finalement duré près de 30 minutes, selon la présidence.
Donald Trump a annoncé la levée de toutes les sanctions américaines frappant la Syrie et demandé à celle-ci de rejoindre les accords d’Abraham et de normaliser ses relations avec Israël. Il a appelé le nouveau régime syrien à expulser "les factions terroristes palestiniennes" hébergées de longue date en Syrie et à "prendre la responsabilité des centres de détention" où se trouvent des membres de l’organisation État islamique contrôlés actuellement par les Forces démocratiques syriennes (FDS) à majorité kurde. Une telle prise de contrôle ouvrirait la voie au retrait de la présence militaire américaine dans le Rojava.
La décision du président américain de légitimer la nouvelle administration syrienne et de lever les sanctions a été saluée comme un "tournant" historique. Elle a donné lieu à des manifestations de liesse dans les rues de Damas. Elle a été suivie, quelques jours plus tard, le 21 mai, par l’annonce par l’Union européenne de la levée de toutes les sanctions économiques contre la Syrie.
"Nous voulons aider le peuple syrien à reconstruire une nouvelle Syrie, inclusive et pacifique", a déclaré Kaja Kallas, la cheffe de la diplomatie européenne, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept.
Cette mesure concerne essentiellement le système bancaire syrien, jusque-là interdit d’accès au marché international de capitaux. Elle prévoit également le dégel des avoirs de la banque centrale syrienne. L’UE se réserve le droit de rétablir ces sanctions en fonction de l’évolution du régime de transition syrien. (Le Monde, 21 mai)
Pour le chef de la diplomatie syrienne, Assad Hassan al-Chibani, "la levée des sanctions exprime la volonté régionale et internationale de soutenir la Syrie. Le peuple syrien a aujourd’hui une occasion historique et très importante de reconstruire son pays".
La levée des sanctions internationales imposées depuis 1979 à la Syrie, renforcées après la répression par la dictature de Bachar al-Assad de manifestations pro-démocratie en 2011, permettra à Damas de recevoir des financements nécessaires pour relancer l’économie et lancer des projets de reconstruction avec le soutien des pétromonarchies du Golfe.
Sur le plan intérieur, le nouveau régime fait toujours face à des défis économiques et sécuritaires énormes. Les affrontements entre les milices druzes et les forces du régime ont fait une centaine de morts et l’accord signé avec les dirigeants de la communauté druze et le gouvernement reste fragile.
Israël, qui abrite une petite communauté druze, se pose en défenseur de celle-ci. Le 2 mai, il a bombardé les abords du Palais présidentiel syrien, pour signifier au nouveau régime qu’il devra cesser sa répression des druzes (New York Times, 2 mai).
Les relations avec l’importante communauté alaouite restent tendues et conflictuelles ; les auteurs de massacres perpétrés contre les alaouites n’ont pas été arrêtés. Certains d’entre eux auraient même été promus, comme les anciens chefs djihadistes d’origine étrangère coupables de nombreux crimes et meurtres. Ils paradent sur les réseaux sociaux au grand dam de leurs victimes.
Ce climat lourd et conflictuel conduit l’ONU à alerter sur le risque d’une nouvelle guerre civile. S’exprimant devant le Conseil de sécurité, Geir Pedersen, émissaire spécial de l’ONU pour la Syrie, souligne "les dangers d’une reprise du conflit et d’une fragmentation du pays restant bien présents" malgré la chute du régime de Bachar al-Assad.
La veille, le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’était lui aussi alarmé, avertissant que la Syrie pourrait être au bord d’une nouvelle "guerre civile à grande échelle" (Le Monde, 21 mai).
Les Kurdes, qui contrôlent et administrent le tiers nord-est du pays, continuent de chercher à régler par le dialogue, la négociation, leurs différences et litiges avec le régime islamiste de Damas sur des questions aussi fondamentales que la Déclaration constitutionnelle, qui tient lieu de constitution du provisoire, l’organisation du pouvoir et de ses institutions sur une base décentralisée et démocratique, incluant toutes les composantes de la mosaïque syrienne et faisant droit à leur revendication d’autonomie locale.
Dans une tribune intitulée "Syrian Freedom is Dangerously Incomplete" parue dans le New York Times du 28 mai, la représentante pour les relations extérieures de l’administration kurde de Rojava, Mme Ilham Ahmed, expose les lignes principales des deux visions divergentes de l’avenir de la Syrie, celle des Kurdes et celle du pouvoir islamiste de Damas, et appelle les alliés occidentaux à soutenir la vision démocratique et décentralisée défendue par les Kurdes pour éviter à la Syrie une nouvelle dictature centralisée qui pourrait conduire à de nouveaux conflits intercommunautaires.
Les négociations kurdo-syriennes, dans le cadre de l’accord en 8 points signé en mars dernier entre le général Mazloum Abdi, chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), et le président syrien par intérim Ahmed al-Charaa, se poursuivent.
Le 27 mai, les deux parties ont convenu d’évacuer les citoyens syriens du camp d’al-Hol, situé dans le désert, qui abrite environ 37 000 personnes ayant des liens présumés avec Daech. Beaucoup sont des épouses et des enfants de combattants de l’organisation djihadiste. Les représentants n’ont pas abordé la question de savoir si Damas prendrait le contrôle du camp à l’avenir (AFP, Euronews).
Les États-Unis font pression pour que le gouvernement central prenne le contrôle des prisons de Rojava où environ 9 000 anciens combattants présumés de Daech sont détenus.
Le président par intérim et son groupe, étant des anciens de Daech et de l’armée salafiste, on peut aisément imaginer le sort qu’ils vont réserver à leurs anciens « frères de combat ».
En février dernier, l’administration kurde avait annoncé, en coordination avec l’ONU, son intention de vider d’ici fin 2025 les camps du nord-est des déplacés syriens et irakiens, y compris les proches présumés des djihadistes.
À Alep, la mise en pratique de l’accord kurdo-syrien sur le contrôle par le gouvernement central des quartiers kurdes d’Achrafieh et de Cheikh Maqsoud, où vivent plus de 500 000 Kurdes, avance progressivement. Sur les sept check-points qui entourent les deux quartiers kurdes, les contrôles se font dorénavant de manière conjointe. Selon le coordinateur local des forces kurdes Mohammed Khalil :
« Jusqu’à présent tout se passe bien, nous faisons notre devoir tous ensemble. Grâce à cela, nos quartiers sont beaucoup plus sûrs qu’avant. »
Les institutions autonomes sont conservées ainsi que certaines particularités.
Mais des points de négociation sont bloqués comme l’échange des prisonniers.
Le nouveau gouvernement est censé rendre aux Kurdes l’ensemble de leurs détenus, mais la plupart d’entre eux se trouvent actuellement dans les prisons turques.
« Le pouvoir syrien ne peut rien faire. Il est trop faible et ne peut pas désobéir aux ordres d’Ankara », explique Nouri Cheikho, coprésident du conseil local, cité par RFI (30 mai).
Pendant ce temps, la guerre de basse intensité contre Daech se poursuit.
Le 15 mai, les FDS ont arrêté 10 individus suspectés d’appartenance à DAECH.
Le 16 mai, dans des accrochages avec des cellules dormantes, un combattant kurde a été tué, trois autres blessés près de la localité d’al-Hamam, à 45 km de la frontière irakienne.
Le 29 mai, pour la première fois depuis la chute du régime d’al-Assad, une patrouille militaire du nouveau gouvernement syrien a été victime d’une mine terrestre actionnée à distance par des djihadistes dans la province méridionale de Soueïda.
Bilan : 1 mort et 3 blessés (AFP, 29 mai).
Profitant du vide de pouvoir et du chaos ambiant, Daech tente de se réorganiser.
Sa guerre est loin d’être finie.
Lors de son voyage aux États-Unis, le Premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, a rencontré le Secrétaire d'État Marco Rubio ainsi que de nombreux sénateurs et congressmen américains pour les tenir informés de l'évolution de la situation politique au Kurdistan, en Irak et dans la région.
Cette visite officielle incluait aussi un important volet économique, avec notamment des rencontres avec les dirigeants des sociétés américaines souhaitant investir au Kurdistan, en tout premier lieu les compagnies pétrolières.
Dans ce cadre, il a signé, le 1er mai, deux importants accords. Le premier, avec Western Zagros, porte sur l'exploitation du bloc de Topkhana qui, avec le bloc voisin de Kurdamir, recèle 5.000 milliards de pieds cubes de gaz naturel et 900 millions de barils de pétrole brut, dont les revenus sont estimés à 70 milliards de dollars sur la durée de vie du projet.
Le second contrat, conclu avec HKN Energy, concerne le champ gazier de Miran et ses 8.000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, valorisés à 40 milliards de dollars à long terme.
Ces accords sont parfaitement conformes à la Constitution irakienne adoptée par référendum en 2005, qui stipule que l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles nouvelles — c’est-à-dire intervenant après l’adoption de la Constitution — relèvent du Gouvernement régional du Kurdistan (KRG), tandis que les ressources antérieures exploitées dans la région autonome relèvent de la cotutelle du gouvernement fédéral de Bagdad ou du KRG.
Cependant, sur cette question comme sur bien d’autres, telles que la dotation financière du Kurdistan, le référendum sur le sort des territoires à majorité kurde dits « contestés », le gouvernement de Bagdad ne respecte pas la Constitution et son esprit de fédéralisme. Il veut imposer aux Kurdes sa vision d’une autorité centrale, d’un centralisme autoritaire hérité des dictatures précédentes.
C’est dans cette logique que, dès l’annonce de ces deux importants contrats avec des sociétés américaines, le gouvernement irakien a porté plainte contre le Gouvernement régional du Kurdistan devant un tribunal de commerce de Bagdad pour contester la validité de ces contrats (AFP, 27 mai).
De son côté, un porte-parole du Département d'État américain a clairement indiqué que l’accord signé avec les deux entreprises américaines correspondait parfaitement à la Constitution irakienne. Pour les autorités kurdes, les deux entreprises américaines figurent déjà parmi les « principaux producteurs du Kurdistan ». Il n’y a donc lieu à aucune contestation juridique (Le Figaro, 27 mai).
Il est à noter que le ministère du Pétrole irakien a porté plainte devant un tribunal commercial de Bagdad et non pas devant la Cour fédérale, dont les décisions sont sans appel. L’Irak, dans le contexte géopolitique agité actuel, n’est pas en mesure de défier Washington. Les litiges entre Bagdad et Erbil continuent d’impacter la vie des citoyens du Kurdistan.
Malgré les stipulations constitutionnelles sur la dotation financière du Kurdistan, malgré l’accord de gouvernement signé entre les partis kurdes et l’actuel Premier ministre, et malgré la loi budgétaire votée par le Parlement, le gouvernement de Bagdad continue de ne pas verser régulièrement les salaires des employés, des fonctionnaires et des retraités du Kurdistan. Excédé par ces manœuvres mesquines et dilatoires, le président du PDK, Massoud Barzani, a déclaré le 15 mai que le traitement réservé par Bagdad aux fonctionnaires et employés du Kurdistan est « inacceptable ». « Bagdad doit traiter avec Erbil d'une manière fédérale, en conformité avec la Constitution », a-t-il rappelé. « Si le fédéralisme n’existe plus, ils doivent nous le dire, parce que le traitement actuel de la Région du Kurdistan n’est pas une relation fédérale. On dirait que les Kurdes sont des étrangers dans ce pays », a-t-il ajouté (Rudaw, 15 mai).
Dans son rapport trimestriel sur le nucléaire iranien, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) alerte sur l’accélération du programme d’enrichissement de l’uranium.
La quantité d’uranium enrichi à 60 % est passée de 605 pounds en février 2025 à 900 pounds, soit environ 410 kg fin mai. Une quantité considérable qui pourrait, en quelques jours, être enrichie à 90 % pour servir de combustible à la fabrication de 10 bombes atomiques selon les experts cités par le New York Times du 31 mai.
Ces derniers estiment que la « weaponization », c’est-à-dire le processus de miniaturisation de la bombe afin d’en faire une tête nucléaire transportable par un missile balistique, pourrait prendre de 6 mois à un an. L’Iran est donc devenu un État de seuil, capable de franchir rapidement le pas pour devenir une puissance nucléaire.
Dans son rapport rendu public fin mai, le directeur général de l’AIEA Rafael M. Grossi écrit que « la production significativement accrue et l’accumulation de l’uranium hautement enrichi par l’Iran, le seul État non puissance nucléaire à produire un tel matériel nucléaire, est une préoccupation sérieuse ». « Nous avons besoin d’obtenir une solution diplomatique et un système très robuste d’inspection par l’AIEA ». Il ajoute que « dans les années récentes, l’Iran a débranché beaucoup de caméras et de senseurs de l’AIEA sur des sites-clés, mais a autorisé les inspecteurs à se rendre dans le pays et mesurer ses stocks croissants d’uranium enrichi » (New York Times, 31 mai).
La perspective de voir l’Iran en capacité de se doter bientôt d’une bombe nucléaire a alerté les pays de la région, et en premier lieu Israël. Son Premier ministre a, le 30 mai, déclaré que « toutes les nations du monde devraient agir maintenant pour arrêter l’Iran ». Il a appelé Donald Trump à se joindre à Israël pour des frappes militaires contre les installations nucléaires de l’Iran. Selon lui, les installations iraniennes de production d’uranium enrichi de Natanz et Fordow sont plus vulnérables que jamais en raison des frappes israéliennes contre les défenses anti-aériennes de l’Iran en octobre dernier. Mais le président américain semble, pour l’heure, privilégier la poursuite de négociations avec l’Iran dont la 4e session n’a toujours pas produit les progrès espérés par Washington.
Le 31 mai, l’envoyé spécial américain Steven Witkof a transmis au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arachchi, une proposition d’accord.
Celle-ci prévoit le démantèlement des installations d’enrichissement d’uranium contre la levée progressive de sanctions américaines et occidentales — une proposition qui n’a guère de chance d’être approuvée par l’ayatollah Khamenei. Pour les dirigeants de la République islamique, qui ont dépensé des milliards de dollars pour ces installations, le droit à l’enrichissement de l’uranium constitue une « ligne rouge » non négociable.
Intervenant sur la chaîne américaine NBC, un haut conseiller de Khamenei, Ali Shamkhani, a affirmé que « l’Iran est prêt à accepter un accord avec les États-Unis sur son programme nucléaire en échange de la levée immédiate des sanctions », ajoutant qu’il s’engagerait à ne jamais fabriquer d’armes nucléaires.
À quoi servirait alors l’enrichissement à 60 % de l’uranium, sachant que le combustible des centrales nucléaires est constitué d’uranium enrichi à moins de 5 %, et que même la propulsion nucléaire des sous-marins n’utilise que de l’uranium enrichi à 20 % ?
Sans doute à préserver ses capacités à fabriquer ultérieurement quelques bombes nucléaires, avec le concours plus ou moins secret de pays comme la Corée du Nord ou la Russie, pour sanctuariser le régime de la République islamique.
Parallèlement à son programme nucléaire, celle-ci poursuit activement le renforcement de son arsenal balistique, dont les progrès inquiètent les Occidentaux. Selon Le Monde du 10 mai, Téhéran possède aujourd’hui plusieurs types de missiles capables d’atteindre l’est de l’Europe. Selon les experts, trois ou quatre types de missiles de portée intermédiaire (IRBM) développés par l’Iran, de portées annoncées de 1.700 à 3.000 km, sont en mesure d’atteindre un arc allant du nord des Alpes italiennes, en passant par l’est de la France, le Danemark, voire la Suède.
Fin mars, le commandement stratégique des États-Unis (Stratcom), chargé de la dissuasion nucléaire, affirmait que l’Iran pourrait bientôt, à travers son programme spatial, se doter d’un missile balistique intercontinental (ICBM) d’une portée supérieure à 5.500 km.
Les missiles iraniens, malgré leur portée affichée, ne seraient toutefois pas en mesure d’assurer une frappe de précision jusqu’en Europe, car ils ne disposeraient pas encore de systèmes de guidage continu et terminal.
La concordance de ces nouvelles alarmantes sur les progrès de l’arsenal balistique et l’accélération du programme nucléaire iranien vise-t-elle à préparer l’opinion publique occidentale à une confrontation militaire pour éliminer, ou du moins réduire, la menace iranienne ? Le président américain avait donné un délai de « quelques semaines ; deux mois maximum » pour les négociations avec l’Iran. En cas d’impasse ou d’échec, il pourrait décider d’accroître considérablement les sanctions visant l’Iran et les pays achetant son pétrole.
Quant à Israël, il semble décidé à utiliser, dès qu’il aura le consentement de Washington, la « fenêtre d’opportunité » exceptionnelle dont il dispose pour attaquer le régime iranien afin d’affaiblir au maximum son potentiel balistique et nucléaire.
En attendant, le régime continue sa guerre contre ses opposants et ses ennemis intérieurs.
Au cours du mois de mai, au moins 165 personnes ont été exécutées dans les prisons iraniennes, soit une augmentation de 143 % par rapport à la même période de 2024, où 67 exécutions capitales avaient été recensées par l’ONG des droits humains Hengaw.
Parmi eux, 26 prisonniers kurdes, 21 lours, 20 baloutches. 5 femmes figurent parmi les suppliciés.
Les médias officiels et les sites affiliés à la justice islamique n’ont rapporté que 6 exécutions sur les 165 recensées.
Toujours en mai, 132 opposants ont été arrêtés, dont 54 Kurdes et 29 baloutches.
Parmi les personnes arrêtées figurent 9 femmes, dont 5 militantes kurdes, 3 femmes bahaïes, 7 enseignants et professeurs d’université, ainsi que 3 écrivains.
Pour les noms des personnes exécutées et des opposants arrêtés, voir le site de l’ONG Hengaw (https://hengaw.net/en/reports-and-statistics-1/2025/06/article-2-1).