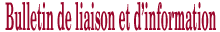Le 26 avril s’est tenue à Qamichli une "conférence historique" de l’unité des Kurdes syriens. Plus de 400 représentants de l’ensemble des partis politiques kurdes et des personnalités de la société civile se sont réunis pour élaborer une position kurde commune et délibérer sur un projet commun pour l’avenir des Kurdes en Syrie et pour la restructuration de l’État syrien après six décennies de dictature. Une délégation du parti pro-kurde DEM ainsi qu’un représentant du leader kurde Massoud Barzani ont assisté à cette conférence.
La conférence, intitulée "Unité de la position et des rangs kurdes", n’a pas pour objectif, comme certains le prétendent, de diviser le pays, mais au contraire de promouvoir l’unité de la Syrie, a déclaré le général Mazloum Abdi lors de l’ouverture de la conférence. "Nous voulons que toutes les composantes syriennes obtiennent leurs droits dans la constitution afin que nous puissions construire une Syrie démocratique, décentralisée et inclusive", a-t-il ajouté.
À l’issue d’une longue journée de débats, les participants ont adopté un "projet de vision politique partagée commune", exprimant une approche réaliste pour une solution juste à la question kurde en Syrie, en tant qu’État démocratique et décentralisé.
Selon un responsable kurde, Mohammed Ismail, cité par l’AFP (26 avril), la déclaration finale constitue "une charte fondatrice d’une Syrie unifiée, plurielle, multiconfessionnelle et multiculturelle, dont la Constitution garantit les droits nationaux du peuple kurde, protège la liberté et les droits des femmes et favorise la participation active à toutes les institutions politiques, sociales et militaires".
La déclaration finale de la conférence appelle à adopter cette vision commune comme "base de dialogue national" entre les forces kurdes ainsi qu’avec la nouvelle administration de Damas et l’ensemble des forces nationales syriennes. Une délégation kurde représentative sera chargée d’engager le dialogue avec les parties concernées pour réaliser les objectifs fixés par la conférence. "Unis autour de ces objectifs, les Kurdes entendent jouer un rôle de premier plan dans les transformations démocratiques radicales en Syrie", affirme dans un message publié sur X un responsable de l’administration autonome kurde, Badran Ciya Kurd.
La conférence de l’unité kurde couronne un processus de dialogue inter-kurde relancé par la rencontre hautement symbolique entre le général Mazloum Abdi et le leader kurde historique Massoud Barzani, en mars 2025 à Erbil. Barzani a usé de toute son influence auprès des partis kurdes syriens opposés à l’administration autonome kurde pour que, dans ce moment critique, ils participent au processus d’unité et de réconciliation.
De son côté, la diplomatie française n’a pas ménagé ses efforts pour favoriser l’unité des rangs kurdes syriens et le dialogue entre ces derniers et ceux de la Région autonome du Kurdistan. Le ministre français des Affaires étrangères, lors de sa visite à Erbil les 23 et 24 avril, a tenu à s’entretenir longuement avec le général Mazloum Abdi, venu spécialement par un hélicoptère militaire pour cette rencontre. Il s’agit d’un geste politique et diplomatique fort, car c’est la première fois que le leader kurde syrien est officiellement reçu par le chef de la diplomatie d’une puissance occidentale.
La présidence syrienne a réagi à la conférence kurde et à son appel à construire un État démocratique et décentralisé en rejetant, le 27 avril, "toute tentative de partition du pays". "Nous rejetons clairement toute tentative d’imposer une réalité séparatiste ou de créer des entités séparées sous le couvert du fédéralisme sans consensus global", a déclaré la présidence dans un communiqué, condamnant "les récentes activités et déclarations des Forces démocratiques syriennes (FDS) qui appellent au fédéralisme". "L’unité de la Syrie, de son territoire et de son peuple est une ligne rouge", ajoute le communiqué.
Même son de cloche du côté turc où les médias ont accordé une large place à la conférence et "au danger de partition de la Syrie", qui ne serait pas conforme à l’accord signé le 11 mars dernier entre le président par intérim syrien et le général Mazloum Abdi. Les réactions sont toutefois restées "mesurées" dans le délicat contexte régional.
Faible et encore mal assuré, le nouveau régime syrien n’est pas en mesure d’engager une épreuve de force avec les Kurdes. Contesté par les Alaouites, il a également dû faire face à la dissidence des Druzes. Après la publication sur les réseaux sociaux d’un message attribué à un Druze et jugé blasphématoire envers l’islam, de violents affrontements ont eu lieu dans la banlieue de Jaramana à Damas, où réside une importante communauté druze. Un premier bilan fait état d’une centaine de morts. Certains chefs druzes dénoncent une "campagne génocidaire", d’autres tentent d’apaiser les esprits.
Se posant en défenseur des Druzes, Israël a bombardé plusieurs positions de l’armée syrienne et menace d’étendre son intervention. Le président turc accuse l’État hébreu de vouloir "dynamiter" la révolution en Syrie. Pendant ce temps, victimes de récents raids sanglants menés par des milices islamistes alliées au pouvoir, des Alaouites se sont enfuis vers le Liban (Le Monde, 14 avril).
Les Kurdes, tout en affichant leurs revendications et leur vision pour l’avenir de la Syrie, continuent d’œuvrer pour la stabilisation du pays. Le 4 avril, dans le cadre d’un accord avec le nouveau régime, les forces kurdes se sont retirées des deux banlieues kurdes d’Alep qu’elles contrôlaient depuis une dizaine d’années. Le 10 avril, un nouvel accord a été conclu entre Damas et les forces kurdes sur le barrage stratégique de Tichrin, sur l’Euphrate, dont celles-ci assuraient le contrôle depuis leur victoire sur Daech. La sécurité du barrage sera désormais assurée par l’armée syrienne, en coopération avec les forces kurdes. À la faveur de cet accord, les violents affrontements qui, depuis décembre dernier, opposaient les forces kurdes aux milices pro-turques, soutenues par l’aviation turque, ont cessé (AFP, 12 avril ; Rudaw, 23 avril).
Cependant, le moment de grâce dont a bénéficié le nouveau régime à ses débuts est désormais révolu. Son image ne cesse de se dégrader auprès des minorités religieuses mais aussi dans les couches urbaines sunnites, qui craignent un nouveau cycle de violences confessionnelles aux conséquences désastreuses, et qui constatent l’incapacité du régime à redresser une économie dévastée. L’héritage de la dictature d’Al-Assad pèse de tout son poids. Chaque semaine, on découvre de nouveaux sites de production de captagon, une drogue de synthèse, à destination des pays voisins. Les inspecteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques affirment qu’il pourrait y avoir 100 sites d’armes chimiques en Syrie. Ils souhaitent se rendre sur place pour évaluer l’état de ces sites de production, de recherche et de stockage, et les sécuriser (New York Times, 6 avril).
Dans une visite à La Haye, en mars dernier, au siège de cette organisation, le ministre syrien des Affaires étrangères s’était engagé à la destruction de ces sites. Mais les inspecteurs n’ont toujours pas pu se rendre en Syrie pour mener leurs propres investigations.
Le vide de pouvoir dans certaines provinces permet à Daech de se réorganiser. Son activité s’est accrue, même dans les territoires sous administration kurde. Le 18 avril, les forces de sécurité kurdes ont lancé une vaste opération pour démanteler les cellules dormantes de Daech à l’intérieur et autour du camp d’Al-Hol. L’opération a permis l’arrestation de 20 djihadistes et collaborateurs de Daech ainsi que la saisie d’armes, de munitions et d’équipements militaires. Une tentative d’évasion massive, coordonnée et impliquant des cellules à l’intérieur et à l’extérieur du camp, a été déjouée (Rudaw, 23 avril).
Le 29 avril, dans des affrontements avec les djihadistes dans la province désertique de Deir ez-Zor, cinq combattants kurdes ont été tués et plusieurs autres blessés (AFP, 29 avril). Dans cette vaste province à majorité arabe longeant la frontière irakienne, où les chefs de tribus arabes changent souvent d’allégeance, Daech semble reprendre des forces.
La recrudescence des activités de Daech devrait inciter la coalition alliée à maintenir sa présence militaire au Rojava. Washington, qui ne semble pas avoir pris de décision définitive sur la question, a annoncé, le 18 avril, la réduction de moitié de ses effectifs en Syrie. "La présence militaire américaine en Syrie va être ramenée à moins d’un millier de soldats dans le mois prochain", contre environ 2 000 actuellement, a déclaré Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué (AFP, 18 avril).
La mobilisation contre l’arrestation du maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, s’est poursuivie à travers toute la Turquie. Ce sont surtout les jeunes, notamment les étudiants, qui sont désormais le moteur de ce vaste mouvement de contestation. Eux qui n’ont connu comme président que l’inamovible et autoritaire Erdogan se disent "exaspérés", privés d’avenir, et reprennent à leur compte la demande d’élections anticipées du leader du CHP (Parti républicain du peuple), Özgür Özel. Cette génération fait montre de convictions fermes. Selon une étude de 2022, citée par Le Monde du 2 avril, 90 % des jeunes se disent insatisfaits du fonctionnement démocratique, 84 % demandent l’égalité des genres et la protection de la liberté d’expression, 86 % soutiennent les droits des femmes et 71 % défendent l’égalité pour les personnes LGBTQ+. Des positions qui sont, pour la plupart, à l’opposé des pratiques du gouvernement actuel.
La liberté d’expression s’est dégradée à tel point que la Turquie se trouve désormais très bas dans le classement annuel de Reporters sans frontières : 158e sur 180, alors qu’il y a à peine 15 ans, elle figurait dans la moyenne du classement. D’où l’un des slogans des manifestants : "Faites à nouveau briller la Turquie !" ou encore "Ne sois pas fâché, ô grand sultan, sois juste responsable". Ils dénoncent la corruption et le népotisme du régime, qui les privent d’avoir des emplois correspondant à leurs diplômes, les obligeant à travailler comme livreurs occasionnels ou caissiers pour survivre, malgré leurs diplômes universitaires.
Ce mouvement de révolte s’étend désormais aux lycées. Le 8 avril, l’annonce de la mutation forcée de plusieurs milliers de professeurs des lycées les mieux côtés du pays a provoqué une vague de colère chez les lycéens. À Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya et dans la plupart des villes moyennes, un mouvement de protestation sous forme de sit-in et de boycottage des cours est venu s’ajouter à la vague de contestation qui déferle sur le pays depuis l’arrestation, le 13 mars, du maire d’Istanbul. Une mobilisation qui a surpris par son ampleur le gouvernement, qui, pour l’atténuer, a décrété le 17 avril une "suspension partielle" de son projet de réaffectation de ces enseignants, qu’il juge proches de l’opposition (Le Monde, 18 avril).
L’un des moments symboliques de la contestation de la jeunesse a été la décision de boycotter les marques des entreprises proches du pouvoir. Celles-ci ont bâti de véritables empires commerciaux, s’étendant des médias — qui censurent les images des manifestations — aux mastodontes du BTP qui raflent les grands projets d’infrastructure, jusqu’aux chaînes de production de biens de consommation quotidienne. Les jeunes manifestants stigmatisent ces oligarques prospérant sur le dos d’une population appauvrie et dénoncent la "poutinisation" de l’économie par le régime d’Erdogan.
Depuis le début des manifestations, le pouvoir turc a déjà arrêté plus de 2 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur turc (Challenges, 11 avril). Parmi eux, des dizaines de proches du maire d’Istanbul. Les prisons turques étant surpeuplées, avec plus de 400 000 détenus, le pouvoir envisage une loi d’amnistie pour les "victimes du sort", c’est-à-dire les criminels de droit commun, afin de faire de la place aux nouveaux prisonniers politiques.
Dans L’Opinion du 2 avril, l’analyste Yaroslav Trofimov s’interroge sur les raisons pour lesquelles "l’Europe ferme les yeux sur la campagne de répression en Turquie". Par le passé, la répression de l’opposition démocratique en Turquie aurait suscité de vives réactions de la part de l’Europe, relève-t-il. Mais aujourd’hui, la rupture des relations transatlantiques et la menace croissante de la Russie l’emportent sur ces préoccupations, selon lui. Il y a surtout la peur d’un nouvel afflux de réfugiés syriens vers l’Union européenne, ce qui incite les dirigeants européens à ne pas irriter le président Erdogan. L’Union européenne verse d’ailleurs des milliards à la Turquie pour qu’elle empêche les réfugiés de venir en Europe, où l’immigration a fini par bouleverser les équilibres politiques traditionnels.
Le quotidien The New York Times dénonce également le silence complice des Etats-Unis. Son Editorial Board a publié dans son édition du 27 avril une tribune intitulée "Turkey’s People Are Resisting Autocracy. They Deserve More Than Silence". Un silence assourdissant qui ne risque pas d’être brisé de sitôt par les chancelleries occidentales, lesquelles font le dos rond face aux turpitudes et aux pratiques répressives de leurs alliés turcs. La Suède s’est retrouvée bien seule à dénoncer l’arrestation d’un journaliste du quotidien Dagens ETC alors qu’il couvrait les manifestations populaires à Istanbul. La justice turque accuse ce journaliste suédois, Joakim Medin, 40 ans, d’avoir participé en janvier 2023 à une manifestation du PKK à Stockholm, au cours de laquelle une effigie du président Erdogan avait été pendue par les pieds. Ce qu’il nie. Il dit qu’il a hâte de dire au juge que "faire du journalisme ne devrait pas être un crime, même en Turquie" (AFP, 3 avril). Son procès s’est ouvert le 30 avril et il risque jusqu’à 12 ans de prison.
Par ailleurs, le processus de paix visant à mettre fin au conflit avec le PKK s’est poursuivi en avril, sans avancée majeure, si ce n’est la rencontre entre la délégation du Parti DEM, composée de Mme Pervin Buldan et de Sirri Süreyya Önder, et le président Erdogan, le 10 avril à Ankara, au palais présidentiel. Dans une déclaration officielle, le parti DEM a qualifié la réunion de "positive, constructive, productive et prometteuse pour l’avenir". Les deux parties ont reconnu l’importance de la phase actuelle et ont souligné le besoin vital d’une nouvelle ère sans violence ni conflit, axée sur le renforcement des voies démocratiques et politiques, affirme le communiqué de DEM. Le président Erdogan n’a pas fait de commentaire.
La France a été l’un des pays occidentaux les plus affectés par les attentats terroristes de Daech. Ce sont les combattants kurdes d’Irak et de Syrie, souvent soutenus par ceux du PKK, qui ont joué un rôle décisif dans la défaite de Daech et dans la destruction de l’État islamique, au prix de plus de 18 000 morts. Ce combat commun pour la défense de valeurs partagées a créé une "fraternité d’armes" qu’après les militaires, les politiques français évoquent à leur tour.
La diplomatie française a désormais une politique kurde, et elle agit pour faire respecter les droits du peuple kurde et la sécurité de "ses frères d’armes".
Les Kurdes sont devenus des acteurs politiques incontournables tant en Irak qu’en Syrie, et les meilleurs alliés de la France dans ce Proche-Orient compliqué, déchiré par des luttes d’influence entre puissances régionales.
C’est dans ce contexte, et pour approfondir le dialogue franco-kurde, que le président Macron a reçu, le 14 avril à l’Élysée, le président de la Région du Kurdistan, Nechirvan Barzani. Au menu de cet entretien, suivi d’un déjeuner de travail : les relations franco-kurdes, la situation en Irak, la relation entre Erbil et Bagdad, la situation en Syrie ainsi que les questions régionales. La question de l’organisation d’un nouveau sommet régional sur l’Irak a également été évoquée.
L’objectif de ce nouveau sommet, que la France appelle de ses vœux, serait de renforcer les relations de Bagdad avec les pays arabes de la région, et avec la France, et à travers elle avec l’Union européenne, pour contrer l’influence iranienne qui prédomine encore dans une bonne partie de la classe politique irakienne.
L’influence de l’Iran à Bagdad a également des conséquences néfastes sur le Kurdistan : l’objectif de l’Iran étant de vider progressivement l’autonomie kurde de sa substance et de la rendre financièrement dépendante de Bagdad. Les sunnites irakiens rejettent également l’influence iranienne, tout comme un nombre croissant de nationalistes chiites. La présence politique kurde à Bagdad, où le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sont kurdes, constitue un point d’appui pour la diplomatie française.
Le dialogue politique franco-kurde, initié par le président Mitterrand, est désormais bien engagé. Les observateurs font remarquer que le président du Kurdistan est le seul chef d’une région autonome à être régulièrement reçu à l’Élysée, quasiment comme s’il était un chef d’État indépendant. À titre d’exemple, ni le président de Bavière ni celui de la Catalogne n’ont jamais été officiellement reçus à l’Élysée.
Après cette visite largement relayée dans les médias kurdes, c’est le ministre français des Affaires étrangères qui s’est rendu au Kurdistan, le 23 avril, après une brève visite à Bagdad, où il a rencontré le Premier ministre irakien ainsi que son homologue Fuad Hussein.
À Erbil, Jean-Noël Barrot a tenu à rencontrer les principaux dirigeants kurdes : le président Nechirvan Barzani, le Premier ministre Masrour Barzani, le vice-premier ministre Qubad Talabani, ainsi que le chef de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), Bafel Talabani. Un moment fort de cette première visite de M. Barrot au Kurdistan a été sa rencontre avec le leader kurde historique Massoud Barzani, ancien président du Kurdistan et chef du Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Le ministre français lui a exprimé la solidarité constante de la France avec le peuple kurde. Les deux dirigeants ont discuté de la nécessité urgente de former un nouveau cabinet dans la région du Kurdistan, de l'état des relations entre Erbil et Bagdad et de la dynamique régionale au sens large. Ils ont tous deux souligné l'importance de l'unité kurde en Syrie et se sont félicités des efforts récents visant à une résolution pacifique en Turquie.
M. Barrot a salué la résilience du peuple kurde et a réitéré l'engagement de la France à soutenir les institutions démocratiques et les réformes en cours. Il a adressé une invitation officielle au président Masoud Barzani à se rendre à Paris pour une cérémonie destinée à honorer les sacrifices des forces peshmerga dans la lutte contre le terrorisme et à inaugurer une allée des Peshmergas dans un parc parisien.
Mettant en avant l'engagement régional de la France, M. Barrot a également souligné la « forte collaboration de son pays pour soutenir le général Mazloum et les entités politiques kurdes en Syrie », notant que de tels efforts visent à favoriser l'unité kurde et à « influencer positivement le processus de transition durable dans la région ».
Le 24 avril, au terme de sa visite à Erbil, le ministre Barrot a rencontré le général Mazloum Abdi, commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS) qui s’est spécialement déplacé pour cet entretien. Selon un communiqué publié par les FDS, le ministre Barrot a salué le rôle clé des FDS dans la lutte contre ISIS et a souligné l'engagement de la France à fournir tout le soutien nécessaire. La réunion a également mis l'accent sur la nécessité d'une participation politique inclusive des Kurdes et de toutes les communautés syriennes afin de parvenir à une stabilité politique, sécuritaire et économique durable en Syrie et d'ouvrir la voie à la reconstruction nationale.
La visite du chef de la diplomatie française a coïncidé avec la tenue à Erbil du 4e Congrès mondial d’études kurdes, coorganisé par l’Institut kurde de Paris et l’Université du Kurdistan-Hewlêr, les 22 et 23 avril, avec la participation de plus de 140 intervenants de 27 pays, dont de nombreux chercheurs français. Le Kurdistan a ainsi vécu une semaine française, où la France était à l’honneur.
Dans le reste de l’actualité du mois, on notera que, malgré de nouvelles réunions, les deux principaux partis kurdes, le PDK et l’UPK, qui affirment s’être mis d’accord sur un programme de coalition gouvernementale, ne sont toujours pas parvenus à former un cabinet. Bagdad n’a toujours pas repris l’exportation du pétrole du Kurdistan, reprise pourtant annoncée comme "imminente" en mars dernier.
En pleine effervescence printanière, le Kurdistan a connu des moments d’émotion avec la commémoration du 37e anniversaire de la campagne génocidaire d’Anfal, lancée par le régime de Saddam Hussein, et qui s’est soldée par la mort de 182 000 civils kurdes et la destruction de 90 % des villages kurdes.
Il y a eu aussi des moments de liesse populaire après la victoire du club de football Duhok SC, qui a remporté en finale du championnat du Golfe une victoire 2-1 contre l’équipe koweïtienne Qadsia. C’est la première fois qu’une équipe kurde devient championne du tournoi de football des pays du Golfe. Cette victoire a eu le mérite d’unir et de combler de joie les Kurdes de tout âge dans la région et de leur faire oublier, pour un temps, les soucis du moment.
L’Iran et les États-Unis ont engagé des pourparlers indirects sous médiation omanaise le 12 avril dans le sultanat d’Oman. Au menu des discussions : le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions américaines contre l’Iran. Selon le New York Times du 13 avril, les deux parties ont fait preuve de pragmatisme et de sérieux pour trouver un terrain d’entente afin d’éviter une nouvelle guerre au Proche-Orient.
Cette première réunion aurait permis de déblayer le terrain et de fixer les paramètres des futures négociations. Elle a été saluée comme "constructive" par les deux parties, et de ce fait, une nouvelle session a eu lieu le 19 avril à Rome. La Maison-Blanche évoque "un pas en avant vers un accord mutuellement satisfaisant". De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à la télévision d’État iranienne que "ni l’Iran, ni les États-Unis ne souhaitent des négociations infructueuses et interminables". Le ministre iranien s’est rendu à Moscou pour informer les dirigeants russes des derniers développements.
De son côté, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est rendu en Iran le 16 avril pour une visite de travail. Dans une interview accordée au Monde du 16 avril, il a exprimé le souhait que l’AIEA soit associée au dialogue américano-iranien sur le dossier nucléaire iranien. Il affirme que l’Iran n’est pas loin de disposer de l’arme nucléaire et ajoute : "Sans nous, tout accord sur l’Iran n’est qu’une feuille de papier."
Malgré les premières annonces plutôt positives, les chances de succès d’une solution négociée restent très incertaines. L’émissaire américaine Steve Witkoff demande le démantèlement du programme nucléaire, et notamment le retrait des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium. Pour l’Iran, l’enrichissement de l’uranium n’est pas négociable (Le Monde, 16 avril), et les capacités militaires de l’Iran sont des "lignes rouges" inaccessibles dans les pourparlers (AFP, 15 avril).
Va-t-on alors vers un accord similaire à celui conclu en 2015 entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne ? Cet accord prévoyait une surveillance accrue du programme nucléaire iranien et le transfert vers un autre pays des stocks d’uranium enrichi, éloignant ainsi, au moins pour quelques années, la perspective de l’accession de l’Iran à l’arme atomique. L’administration Trump avait, en 2018, dénoncé cet accord et décidé du retrait des États-Unis, accompagné d’une série de sanctions sévères pour exercer une "pression maximale" sur l’Iran.
L’Iran n’a pas cédé à cette pression et a même accéléré son programme nucléaire. Principal allié des États-Unis au Proche-Orient, Israël ne cache pas sa préférence pour une intervention militaire contre un Iran plus affaibli que jamais, afin d’anéantir ses installations nucléaires. Selon le New York Times, Israël avait planifié une attaque contre les sites nucléaires iraniens, mais il en a été empêché par le président Trump, qui voulait donner sa chance à la diplomatie. Le soutien américain à une telle opération est crucial à la fois pour son succès et pour défendre Israël contre d’éventuelles représailles iraniennes.
Cependant, le président Trump accorde un délai de deux mois aux pourparlers de paix. En cas d’échec, il menace de mener une action militaire contre l’Iran tout en affirmant qu’il est prêt à rencontrer les dirigeants iraniens pour conclure un "deal" et éviter une confrontation militaire (New York Times, 25 avril).
Le 26 avril, un incendie a dévasté le port iranien de Chahid Rajai, faisant 46 morts et plus d’un millier de blessés. La déflagration, entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, s’est produite sur le quai de ce port stratégique par lequel transitent 85 % des marchandises en Iran. Selon les douanes, elle proviendrait "probablement" d’un incendie dans un dépôt de matières dangereuses et chimiques, à l’instar de celui survenu au port de Beyrouth (AFP, 28 avril).
Dans un pays où la théorie du complot est un sport national, on n’hésite pas à évoquer un sabotage par une puissance étrangère, en l’occurrence Israël. Le 30 avril, l’Iran a annoncé avoir exécuté "un espion de haut rang" lié à Israël. Officiellement, cette exécution n’a rien à voir avec l’incendie du port. Le supplicié était accusé d’avoir "acheté une moto pour surveiller" un colonel des Gardiens de la Révolution, Hassan Sayyed Khodaï, tué le 22 mai 2022 à Téhéran.
Le timing de l’exécution fait tout de même réfléchir les Iraniens, qui avaient déjà attribué au Mossad la mort dans un accident d’hélicoptère de l’ancien président Raïssi, de retour d’un voyage en Azerbaïdjan.
L’Iran est champion toutes catégories dans le sinistre domaine des exécutions capitales. Dans un rapport publié le 8 avril, Amnesty International recense 1 518 exécutions dans le monde en 2024, dont 64 % en Iran avec 972 personnes mises à mort — soit 119 de plus que l’année précédente. Il surclasse ainsi sa rivale l’Arabie saoudite, qui, elle, a décapité 345 personnes (Le Monde, 8 avril).
Cette pratique funeste ne connaît pas de relâche en 2025, notamment au Kurdistan.
Le 20 avril 2025, Hamid Hoseinnezhad Heidaranlou, un prisonnier politique kurde de 40 ans, père de trois enfants, originaire de Chaldoran, a été exécuté en secret à la prison centrale d'Urmia. Arrêté en avril 2023 près de la frontière du Chaldoran, Heidaranlou a enduré près de deux ans de détention brutale marquée par l'isolement, la torture et le refus de toute représentation légale et de toute visite familiale. Bien que son passeport indique clairement qu'il se trouvait hors d'Iran le jour de l'affrontement armé présumé, il a été condamné à mort pour « rébellion armée contre l'État » (baghi) en raison de ses liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Selon l'organisation Hengaw pour les droits de l'homme, la condamnation a été prononcée sur la seule base des « connaissances » personnelles du président du tribunal, au cours d'un procès qui n'a duré que quelques minutes et sans aucune preuve crédible.
Par ailleurs, la Cour suprême iranienne a rejeté une deuxième demande de révision du procès de Pakhshan Azizi, journaliste kurde et prisonnier politique actuellement détenu à la prison d'Evin. Condamnée à mort le 14 juin 2024 sur la base d'accusations de rébeillon, Pakhshan Azizi risque désormais une exécution imminente. Son avocat, Maziar Tataei, a révélé que le tribunal avait rejeté la demande sans avoir examiné les documents du procès, estimant que les arguments de la défense étaient sans fondement. Le tribunal avait déjà rejeté une première demande de nouveau procès en février. Outre la condamnation à mort, les autorités ont infligé à M. Azizi une peine de six mois dans une affaire distincte pour avoir prétendument « fomenté des troubles en prison ». M. Azizi a été arrêté le 4 août 2023 à Téhéran et transféré à la prison d'Evin en décembre de la même année.
Dans le cadre de la répression continue des personnalités culturelles kurdes, les autorités iraniennes ont également emprisonné Serveh Pourmohammadi, 36 ans, professeur de langue kurde et membre de l'ONG Nojin. Elle a été placée en détention le 19 avril 2025 à Senna et transférée dans le quartier des femmes de la prison centrale de Senna pour commencer à purger une peine de cinq ans. Initialement condamnée à dix ans en novembre 2023 par la branche 1 du tribunal révolutionnaire de Senna pour avoir prétendument « formé un groupe pour perturber la sécurité nationale », la cour d'appel a ensuite réduit la peine, et le verdict final a été rendu en novembre 2024.
En outre, Shohreh Ghamar, une actrice kurde de 32 ans originaire de Bijar et résidant à Téhéran, a été condamnée à 56 mois de prison pour son activisme politique et social. Le 12 avril 2025, le tribunal révolutionnaire de Téhéran l'a condamnée à trois ans et six mois pour « soutien à Israël » et à 14 mois supplémentaires pour « diffusion de fausses informations en faveur du mouvement « Femmes, vie, liberté » et incitation de l'opinion publique ». Les autorités avaient déjà condamné Mme Ghamar à 15 mois pour avoir soutenu le même mouvement. Son avocat a fait appel de cette décision. Mme Ghamar avait été arrêtée par le ministère des renseignements le 5 août 2023 pour des messages « offensants » qu'elle aurait postés sur les réseaux sociaux.
L’Institut kurde de Paris organise depuis 2006 des congrès mondiaux d’études kurdes en partenariat avec les universités du Kurdistan.
Le 4ème de ces congrès s’est tenu les 22 et 23 avril à Erbil à l’Université du Kurdistan-Hewlêr.
Plus de 140 chercheurs et universitaires venant de 27 pays ont présenté des communications sur des sujets couvrant les divers domaines des études kurdes. Beaucoup d’étudiants de l’université ont suivi ces présentations, suivies de débats, avec grand intérêt, et ont fait la connaissance de chercheurs venus d’ailleurs tout au long de ces deux journées riches et intenses.
Les échanges, porteurs de futures coopérations, devraient avoir un impact important sur les perspectives d’études kurdes. Les médias locaux ont consacré une large couverture à ces journées et interviewé de nombreux intervenants.
Les actes du congrès seront mis en ligne et publiés ultérieurement.
Voici, à titre d’information, le texte du discours de bienvenue prononcé par Kendal Nezan, à l’ouverture de ce congrès.
Mot de bienvenue
Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce 4e Congrès mondial d'études kurdes, coorganisé par l’Institut kurde de Paris, l’université du Kurdistan à Erbil et le Ministère de l’Enseignement supérieur du Kurdistan.
Les précédents congrès, organisés par l’Institut kurde, avaient eu lieu en septembre 2006 à l’Université Salahaddin d’Erbil, en mai 2011 à l’Université de Duhok, et en novembre 2019 en partenariat avec les Universités de Zakho et de Koya.
L’objectif principal de ces congrès et conférences est de faire le point sur l’état des recherches dans les divers domaines de la connaissance du monde kurde, de débattre des perspectives et — last but not least — de créer des liens entre les chercheurs du Kurdistan et ceux venant des quatre coins du monde, de favoriser les échanges et les synergies, et de contribuer ensemble à une meilleure connaissance du peuple et du société kurde.
D’un congrès à l’autre, nous constatons avec plaisir l’intérêt croissant pour les études kurdes. Ainsi, à Erbil, il y a presque 20 ans on avait pu réunir une vingtaine d’universitaires occidentaux dont les interventions devaient être traduites en kurde pour les étudiants et chercheurs kurdes d’ici.
Aujourd’hui, nous avons 140 participants de 27 pays qui présentent des communications sur une quinzaine de thèmes, classiques, comme la langue, la littérature, l’histoire, mais aussi sur des sujets plus récents comme les gender studies, genocide and memory studies, AI and Kurdish studies, peace building and reconciliation, global Kurdish diaspora ou regional and international dynamics of Kurdistan — un très vaste panorama des divers domaines de la recherche sur le monde kurde, son passé, son présent et ses perspectives.
La richesse et la diversité de ce programme, le nombre et la qualité de ses intervenants reflètent les progrès considérables accomplis ces dernières années. Mais dans le domaine des études kurdes, on revient de loin. De vastes domaines allant de l’archéologie du Kurdistan à l’histoire préislamique des Kurdes, à l’étude de la littérature orale et du folklore kurde « hypertrophié », selon le mot du célèbre ethnologue russe Vilchevsky, les musiques populaires, savantes et religieuses kurdes, le patrimoine artistique kurde restent encore largement à explorer.
Privés d’État et d’institutions pendant près de deux siècles, les Kurdes n’ont guère eu la possibilité d’étudier, de connaître et de valoriser leur culture et leur patrimoine historique et artistique. Au cœur d’une région qui fut l’un des tous premiers foyers de la civilisation humaine, le Kurdistan est resté longtemps inaccessible aux chercheurs occidentaux. L’histoire de la région s’est longtemps écrite sans eux, voire contre eux, dans les récits des États se partageant le Kurdistan. Les Kurdes ont souvent été tenus pour "inexistants" et invisibilisés.
Au cours des dernières décennies, par leur combat pour la liberté, par leur rôle éminent dans les dynamiques régionales et internationales, ils émergent de ce "trou noir" de l’histoire. De victimes déplorées des injustices du XXe siècle, ils deviennent les acteurs de leur propre histoire. Le courage de leurs combattants, notamment des femmes, contre les djihadistes de Daech, a rendu le peuple kurde visible et apprécié dans l’opinion publique internationale. La jeune étudiante kurde Jîna Mahsa AMINI est devenue une icône mondiale du combat des femmes pour la liberté et l’égalité.
Le développement des études kurdes s’inscrit dans cette nouvelle dynamique. La kurdologie n’est plus une modeste niche réservée à quelques esprit curieux, mais une discipline en vogue. On publie désormais au Japon des mangas sur les Kurdes ; des étudiants chinois apprennent le kurde, on fait des recherches sur le cinéma kurde au Mexique, un personnage de Woody Allen suit un programme de Kurdish Studies à l’Université de Columbia.
Amis chercheurs ici rassemblés, rassurez-vous : vous êtes tout à fait à la mode ! Les Kurdes sont à la page, et ils pourraient bien le rester encore longtemps. Nous avons donc beaucoup à faire ensemble. Une meilleure connaissance du monde kurde apportera aussi un éclairage nouveau sur la compréhension de toute cette partie du monde.
Au nom de l’Institut kurde, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue à celles et ceux qui viennent des pays lointains, bienvenue aussi aux chercheurs venant de Bakur, de Rojhelat et de Rojava. Nous avons hâte de vous écouter et d’apprendre avec vous.
Pour finir, je voudrais exprimer mes plus chaleureux remerciements à l’Université du Kurdistan qui vous accueille ici. Ses équipes n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer le succès de cette conférence.
Nous sommes très heureux et émus d’être aujourd’hui dans cette belle université, qui a été fondée par l’un de nos anciens vice-présidents, Dr Abbas VALI, et construite grâce à deux membres distingués de notre Institut la regrettée Ferda Cemil Pasha et Dana QASHANI, sans doute présent dans la salle.
Un grand merci aussi à notre partenaire, le Ministère de l’Enseignement supérieur du Kurdistan, qui a notamment pris en charge une partie des frais de cette conférence.
Les ministères français des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur, par l’intermédiaire de l’Institut kurde qu’ils cofinancent, ainsi que l’ambassade de France à Bagdad, ont également soutenu cette conférence. Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur soutien.
Merci à vous toutes et tous de votre participation, et très bonne conférence !
À l’occasion du 40e anniversaire de sa fondation, l’Institut kurde a mis en chantier la publication d’un ouvrage de référence sur l’Histoire des Kurdes, afin de faire le point sur l’état de nos connaissances et des recherches en cours sur cette question chère au cœur des Kurdes et de leurs amis.
Le professeur Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, a bien voulu se charger de la direction de cet ouvrage collectif, préfacé par Kendal Nezan. Outre Hamit Bozarslan, qui a rédigé une longue et savante introduction, Josef Wiesehöfer, professeur à l'université de Kiel, Allemagne, Boris James, maître de conférences à l’université Paul-Valéry de Montpellier, Metin Atmaca, professeur à l'université des sciences sociales d'Ankara, et Cengiz Gunes, senior lecturer à Open University, UK, ont contribué à cet ouvrage de 613 pages, publié aux éditions du Cerf.
Le Monde du 28 avril a consacré une page à la publication de cet ouvrage avec un entretien avec Hamit Bozarslan, lire article (P.104-105).
Le livre est disponible à l’Institut et dans notre boutique en ligne.