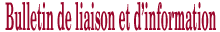Dans le cadre du « processus de paix » en cours, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a, le 26 octobre, annoncé le retrait de toutes ses unités militaires de Turquie.
Celles-ci ont été redéployées vers ses bases situées au Kurdistan irakien en attendant l'adoption par la Turquie de « mesures juridiques » autorisant le retour des combattants ayant déposé leurs armes.
Dans le communiqué annonçant ce retrait, le PKK souligne que « le processus traverse une phase extrêmement importante et critique. (...) Nous procédons au retrait de toutes nos forces en Turquie, qui présentent un risque de conflit à l’intérieur des frontières turques et sont vulnérables à d’éventuelles provocations ».
Aucune précision n’a été apportée sur le nombre de combattants faisant l’objet du retrait. Selon les observateurs, il pourrait s’agir de 200 à 300 guérilleros qui, depuis le cessez-le-feu annoncé le 1er mars dernier, étaient restés discrets.
Le PKK appelle Ankara à prendre « sans délai » les mesures juridiques nécessaires pour sauver le processus de paix. Lancé il y a un an, il exige l’accélération des négociations et la mise en place des lois garantissant « les libertés et l’intégration démocratique » des membres du PKK dans la société.
Le gouvernement turc a réagi à cette annonce par la voix du vice-président Cevdet Yilmaz, qui a salué « un pas important dans la bonne direction », soulignant que l’objectif principal restait « l’élimination de tous les éléments de l’organisation terroriste ».
De son côté, le porte-parole du parti présidentiel, Ömer Celik, voit dans l’annonce du retrait des « résultats concrets » des efforts visant à mettre fin au conflit.
À Bagdad, la Commission des relations étrangères du Parlement a averti, le 26 octobre, que le déplacement des combattants du PKK de Turquie vers l’Irak constituait une menace pour la sécurité nationale et risquait d’entraîner le pays dans des conflits régionaux.
Pendant ce temps, la Commission parlementaire ad hoc a poursuivi ses auditions. Son président, Numan Kurtulmus, qui est aussi président de la Grande Assemblée nationale turque, s’est rendu, le 17 octobre, à Diyarbakir, capitale politico-culturelle du Kurdistan de Turquie.
Accompagné de 30 députés membres du bureau de l’Assemblée et de la Commission de dialogue, il a assisté à l’ouverture de l’année académique de l’université Dicle.
S’adressant à un auditoire en grande majorité kurde, il a affirmé que « la langue maternelle est un droit aussi légitime que le lait maternel » et terminé son discours par quelques mots en kurde sur la paix et la fraternité, une première dans les annales de la République turque, de la part d’un haut dirigeant turc.
Il a estimé que l’objectif du processus en cours est de mettre fin à l’effusion de sang, que cette fois nous réussirons, la paix triomphera, la fraternité triomphera. Il a également évoqué l’esprit de tolérance et de fraternité du prince kurde Saladin, qui doit nous inspirer et nous guider.
En bons musulmans, le président du Parlement et les députés qui l’accompagnaient se sont rendus ensuite à la prière du vendredi à la Grande Mosquée (Mizgefta Mezin) de Diyarbakir, datant du 9e siècle et considérée comme la plus ancienne de Turquie.
En un geste d’ouverture, il s’est également rendu à la mairie de Diyarbakir où sa délégation a été reçue par les deux co-maires de la capitale kurde. C’est la première fois depuis 26 ans qu’un président du Parlement rend visite à cette mairie, dont plusieurs maires élus précédemment ont été destitués et embastillés, remplacés par des administrateurs nommés par l’État (kayyum).
Certains partis turcs continuent de s’opposer à ces « négociations avec les terroristes ». Il s’agit notamment du bien mal nommé Iyi Parti (le Bon Parti), une formation ultra-nationaliste turque issue d’une scission du Parti de l’action nationaliste (MHP), extrême-droite de Devlet Bahçeli associé à la coalition gouvernementale.
Le 15 octobre, le vice-président d’Iyi Parti Turhan Çömez s’en est violement pris, de la tribune du Parlement, à la députée kurde Pervin Buldan, vice-présidente du Parlement et membre de la délégation du parti DEM qui fait la navette entre l’île-prison d’Imrali, où elle rend visite au chef du PKK, et les officiels turcs.
Sa mission de médiation avec « le chef des terroristes », salirait la réputation du Parlement et serait une infamie, selon Çömez.
Le député kurde d’Ağrı, Sırrı Sakık, lui a répondu de la même tribune du Parlement en ces termes :
« Savez-vous ce qu’est la véritable infamie ? Sont infâmes ceux qui, après avoir créé la Turquie avec les Kurdes, les ont reniés comme inexistants.
Sont infâmes ceux qui ont interdit la langue d’un peuple.
Sont infâmes ceux qui confisquent les droits d’un peuple.
Savez-vous qui est infâme ? Ce sont ceux qui ont massacré, assassiné des dizaines de milliers de Kurdes par des assassinats dont les auteurs n’ont pas été identifiés et qui n’ont pas élevé la voix.
Sont infâmes ceux qui ont brûlé trois mille cinq cents villages kurdes.
Ceux qui veulent que les tueries continuent sont infâmes. Ceux qui disent que la guerre doit se poursuivre sont des tâches. »
Les échanges vifs au sein même du Parlement turc ont suscité la colère du président du Parti de la Victoire, une autre formation ultra-nationaliste turque, Ümit Özdağ, qui a publié sur son compte X que s’il était au Parlement il aurait « roué des coups » le député Sakık qui « insulte Atatürk, notre guerre d’indépendance et la République turque » (Rudaw, 16 octobre).
Pendant ces échanges d’amabilités au Parlement turc, la principale formation de l’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), poursuit son chemin de calvaire. Les arrestations de ses maires et élus sous des prétextes variés et souvent fallacieux continuent.
Les poursuites judiciaires se multiplient.
Se faisant l’écho de ce climat dépressif, Le Monde titre :
« Même après deux décennies d’Erdogan, personne ne s’attendait à une telle escalade dans l’arbitraire » (Le Monde, 16 octobre).
Une justice instrumentalisée, politique, prompte à instruire les procès des opposants politiques mais d’une extrême inertie pour tirer au clair les épisodes les plus sombres de l’histoire récente du pays.
Les assassinats de milliers de civils kurdes, avocats, médecins, étudiants, écrivains, syndicalistes, défenseurs des droits de l’homme abattus dans les années 1990, courent toujours tout comme leurs commanditaires.
L’attentat de la gare d’Ankara qui, le 10 octobre 2015, a fait 104 morts dans une foule de manifestants réclamant la fin de la guerre avec le PKK et un règlement pacifique de la question kurde n’est toujours pas élucidé.
Les victimes, en grande majorité kurdes, et leurs familles estiment que la justice n’a pas été rendue et que leur statut de victimes n’a même pas été reconnu (RFI, 9 octobre).
La crise économique et sociale frappe durement les classes populaires.
Le quotidien Le Monde publie dans son édition du 29 octobre un reportage de son correspondant, dont le titre résume à lui seul la gravité de la situation :
« La Turquie risque de perdre toute une partie de sa jeunesse, ni employée, ni scolarisée, ni en formation ».
Selon cet article bien documenté : « plusieurs rapports ont mis en lumière le décrochage vertigineux de l’enseignement supérieur turc, et en corollaire celui de toute une génération, près de 30% des 18-24 ans n’étant ni employés, ni scolarisés, ni en formation, 42% des femmes sont hors de tout circuit et plus d’un million d’enfants sont sur le marché du travail ».
Pendant ce temps, la Turquie d’Erdogan, qui se veut une « puissance globale », investit massivement dans les industries de l’armement, construit un porte-avions plus grand que le Charles-de-Gaulle français et vient de signer un contrat de 9 milliards d’euros avec Londres pour l’achat de 20 avions Eurofighter.
Elle renforce sa coopération militaire avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui préfèrent désormais garder le silence sur la dérive autoritaire du régime turc. (Le Monde, 31 octobre).
Le nouveau régime syrien cherche à se donner un minimum de légitimité démocratique. À cette fin, à défaut de tenir des élections parlementaires au suffrage universel direct, il a organisé une consultation auprès d’environ 6000 grands électeurs. Ceux-ci étaient désignés par des comités électoraux locaux mis en place par une commission électorale nommée par le président intérimaire al-Charaa, lequel s’est arrogé le pouvoir de nommer personnellement un tiers des membres de ce « Parlement ».
La plupart des gens formant le collège électoral sont des islamistes ou proches du gouvernement et pour l’essentiel des Arabes sunnites. Les provinces sous contrôle des Forces démocratiques kurdes, comme Hassaké et Raqqa, ainsi que la province à majorité druze de Soueïda étaient exclues de cette singulière consultation en raison des défis sécuritaires. 32 sièges sur 210 resteront de ce fait vacants. Selon la Commission électorale, 1578 candidats, dont seulement 14 % de femmes, ont été autorisés à se présenter au scrutin. Selon les règles électorales, les candidats ne doivent pas être « des partisans de l’ancien régime ni promouvoir la sécession ou la partition ». (Le Monde, 5 octobre).
Ce sont les Kurdes et les Druzes réclamant la décentralisation du régime qui sont considérés comme « sécessionnistes » et donc disqualifiés d’office.
Les quelque 6000 grands électeurs étaient donc appelés à choisir dans leurs rangs, parmi les 1578 candidats, 140 députés. À l’issue de cette singulière consultation dont les résultats ont été annoncés le 6 octobre par Nawar Najmeh, le porte-parole de la commission électorale, on constate que les femmes ne représentent que 4 % des parlementaires ainsi désignés et les chrétiens obtiennent 2 sièges. Aucun représentant d’un parti kurde ou alévi ou druze.
Répondant aux critiques, M. Najmeh a reconnu un « déséquilibre ». « La composante chrétienne ne dispose que de deux sièges, une représentation faible en regard de sa proportion dans la population syrienne », a-t-il acquiescé. « La place des femmes dans le Parlement ne reflète pas leur rôle dans la société syrienne ni dans la vie politique et sociale », a-t-il ajouté. Il a toutefois affirmé que les nominations à venir par le président, des 70 députés restants, « pourraient compenser » la sous-représentation de « certaines composantes de la société ». (Le Monde, 6 octobre).
Les autorités kurdes ainsi qu’une quinzaine d’ONG syriennes ont dénoncé cette « farce électorale » et souligné qu’il s’agissait plutôt d’une nomination sans précédent dans l’histoire du pays. Même le dictateur déchu Bachar al-Assad tenait au moins à respecter les formes d’un scrutin électoral à suffrage direct et universel, quitte à en exclure des opposants et à manipuler les résultats.
Ce « Parlement » de transition a un mandat de deux ans et demi, renouvelable. Il sera chargé de proposer et d’amender les lois, d’approuver les traités internationaux et d’adopter le budget de l’État.
L’essentiel de ce budget, notamment les salaires des fonctionnaires et les soldes des militaires, sont depuis le début de l’année payés par le Qatar, le co-parrain avec la Turquie, frère musulman du nouveau pouvoir. De son côté, l’Arabie saoudite a commencé à livrer du pétrole à Damas. Les investisseurs des pétromonarchies attendent la levée officielle et totale des sanctions internationales frappant la Syrie pour participer au gigantesque chantier de sa reconstruction, dont le coût est évalué à 216 milliards de dollars par la Banque mondiale dans un rapport publié le 21 octobre. Les infrastructures comme les voies de communication représentent près de la moitié du total des dépenses à engager, suivies par les bâtiments résidentiels. Le président syrien de transition chiffre, lui, à 1000 milliards d’euros le budget nécessaire pour reconstruire le pays, un chiffre rond qui ne se repose sur aucune étude connue. (RFI, 21 octobre).
Pour asseoir sa légitimité et créer un climat de stabilité favorisant les investissements étrangers, il poursuit sa diplomatie d’ouverture tous azimuts. Après ses visites dans les pays du Proche-Orient, en France, aux Nations unies, et avant une visite attendue à Washington en novembre, il s’est rendu à Moscou où il a, le 15 octobre, été reçu avec égards par le président russe Poutine, son pire ennemi durant la guerre civile syrienne.
Dans son discours préliminaire de bienvenue, le président Poutine a mis l’accent sur « des décennies de relations amicales entre Moscou et Damas depuis l’accession de la Syrie à l’indépendance en 1944 » et émis le voeu d’un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Moscou a fait part de son souhait de garder sa base aérienne de Hmeimim et de continuer à utiliser le port de Tartous sur la côte méditerranéenne. La base aérienne et le port de Tartous sont les seules escales en Méditerranée orientale pour les avions et les bateaux allant ou venant d’Afrique. En contrepartie, la Russie continuerait de fournir à la Syrie du blé, du pétrole, de l’acier et sans doute également des armements, notamment des systèmes de défense anti-aérienne, indispensables contre les incursions régulières de l’aviation israélienne. Le président syrien a visiblement voulu s’assurer également du soutien diplomatique russe au Conseil de sécurité de l’ONU pour la levée des sanctions le visant personnellement, ainsi que son mouvement HTC, ex-branche de l’organisation terroriste al-Qaida.
Lors de cet entretien, il aurait aussi demandé l’extradition vers la Syrie de l’ex-dictateur Bachar al-Assad afin qu’il y soit traduit en justice, demande qui restera sans doute sans suite. Plutôt que d’extrader cet exilé encombrant, Moscou saura, le moment venu, s’en débarrasser discrètement.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), l’ex-président syrien, après une « tentative d’emprisonnement », a été admis le 20 septembre dans un hôpital près de Moscou dans un « état critique en soins intensifs ». Seul son frère Maher al-Assad avait été autorisé à lui rendre visite pendant son hospitalisation, avec l’ancien secrétaire aux affaires présidentielles Mansour Azzam, affirme l’OSDH dans un rapport publié le 2 octobre. (Le Figaro, 6 octobre).
Selon le New York Times du 15 octobre, la visite à Moscou d’al-Charaa aurait été conseillée par le président turc afin d’équilibrer les risques de ses relations avec les Occidentaux. En septembre, pour préparer cette visite, Moscou avait dépêché à Damas une importante délégation conduite par le Vice-Premier ministre Alexandre Novak, principal stratège en énergie de M. Poutine. M. Novak avait notamment été reçu par le frère d’al-Charaa, Maher al-Charaa, en charge de l’économie, qui parle russe et qui est marié à une Russe. Après cette visite, une délégation du ministère syrien de la Défense s’était rendue en Russie où elle a notamment visité un centre de formation aux systèmes de défense anti-aérienne. Les deux parties semblent disposées à tourner la page des hostilités et griefs d’hier pour engager sur de nouvelles bases une coopération militaire et économique. (New York Times, 15 octobre).
Sur le plan intérieur, la tension reste toujours palpable entre les Forces démocratiques syriennes (FDS), à dominante kurde, et les diverses milices islamiques « intégrées » à la va-vite dans la nouvelle armée syrienne en formation, mais qui obéissent toujours à leurs chefs de bande et qui continuent de se livrer à de nombreuses exactions dans les territoires kurdes syriens sous occupation turque, comme le canton d’Afrin.
Pour contrer leurs exactions, les FDS ont maintenu une force de protection dans les quartiers à forte majorité kurde de Cheikh Maqsoud et d’Ashrafieh à Alep, où vivent plus de 400 000 Kurdes. Les FDS ont, le 6 octobre, résisté à une tentative d’intrusion de l’une de ces milices portant l’uniforme syrien. L’accrochage a fait deux morts, dont un milicien et un civil.
Pour éviter un dérapage, le gouvernement syrien et l’administration autonome kurde ont conclu un cessez-le-feu. Selon l’OSDH, les forces gouvernementales avaient utilisé des drones explosifs dans ces quartiers à majorité kurde encerclés, dont les communications avaient été coupées. Le ministre de la Défense de transition a, le 7 octobre, annoncé sur X « un cessez-le-feu immédiat entre les forces du gouvernement et les forces kurdes. Tous les axes et positions militaires dans le nord et le nord-est de la Syrie sont concernés par ce cessez-le-feu qui doit être appliqué immédiatement ».
Le ministre a annoncé s’être réuni avec Mazlum Abdi, le commandant en chef des FDS, et avoir convenu d’un « cessez-le-feu global sur l’ensemble des axes et points de déploiement militaires dans le nord et le nord-est de la Syrie ».
Le général Mazlum Abdi a rencontré le même jour à Damas le président de transition sous l’égide d’une délégation américaine. Les discussions auraient abordé des questions fondamentales pour les autorités kurdes : le retour des populations kurdes déplacées, la lutte contre le terrorisme et la modification de la constitution provisoire syrienne afin de mieux assurer la protection des minorités du pays, selon le communiqué publié par la partie kurde à l’issue de cette rencontre au sommet.
La question de l’intégration des FDS au sein de la nouvelle armée syrienne a aussi été discutée en détail au cours de ce sommet.
Des discussions techniques se sont poursuivies entre les deux délégations et ont abouti à un « accord de principe » annoncé le 13 octobre par le général Abdi à l’AFP. Il n’a pas précisé les mécanismes d’intégration des FDS et des forces de sécurité (Asayish kurdes) au sein des ministères de la Défense et de l’Intérieur.
Le 17 octobre, dans une interview accordée à l’agence Associated Press, il affirme :
« Nous disposons de dizaines de milliers de soldats et de forces de sécurité intérieure. Les forces rejoindront l’armée nationale non pas individuellement, en petits groupes, mais en unités militaires constituées selon les règles fixées par le ministère de la Défense ».
De son côté, Abou Omar al-Idlibi, haut commandant des Forces démocratiques du Nord, une composante des FDS, déclare dans un entretien accordé à la chaîne d’info kurde Rûdaw que les FDS seront intégrées en trois unités militaires et plusieurs brigades indépendantes, dont une brigade des unités de protection des femmes (YPJ). Certaines de ces brigades, aguerries dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, pourraient être déployées dans d’autres régions de Syrie pour aider le gouvernement intérimaire à combattre l’État islamique, le Daech.
La mise en place de cet « accord de principe » pourrait encore prendre de longues négociations. Aucun calendrier n’est prévu pour la modification de la constitution provisoire, pour garantir les droits du peuple kurde et d’autres composantes de la mosaïque syrienne, ni pour la reconnaissance de Newroz, le Nouvel An kurde, comme une fête nationale et un jour férié en Syrie.
L'Irak est devenu l'un des pays souffrant le plus de la pénurie de l'eau, de la sécheresse et de la désertification qui progresse année après année, notamment dans le Sud où les marais sont désormais à sec. Ce pays qui pendant des millénaires était connu sous le nom de Mésopotamie, est actuellement en grande partie privé des ressources hydrauliques de ses deux fleuves nourriciers : le Tigre et l'Euphrate, qui prennent leurs sources dans les montagnes du Kurdistan du Nord. La Turquie a construit depuis les années 1970 un vaste système de barrages, appelé le Projet d'Anatolie du Sud-Est (GAP), pour maîtriser, contrôler et utiliser à son profit les eaux de ces deux fleuves et de leurs affluents. Elle prive ainsi ses voisins l’Irak et la Syrie de leur part de cette ressource vitale. Dans les années 1980-1990, le régime de Damas a accueilli et soutenu le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dans sa lutte armée contre la Turquie, afin de disposer, le moment opportun, d'une carte de négociation avec Ankara pour un partage plus équitable des eaux de l'Euphrate. Tout comme dans les années 1960-1970, le Chah d’Iran avait soutenu le mouvement de guérilla du général Barzani contre le régime de Bagdad pour obtenir des concessions sur le contrôle de Chatt-al-Arab, le delta où se rejoignent le Tigre et l’Euphrate avant de se verser dans le golfe arabo-persique et qui forme la frontière entre l’Iran et l’Irak.
Face à la Turquie, l’Irak d’aujourd’hui ne peut faire valoir que ses relations commerciales et son marché. Les exportations turques vers l’Irak s’élèvent à plus de 30 milliards de dollars par an dont près d’un tiers (environ 10 milliards de dollars) vers le Kurdistan irakien. La capitale kurde, Erbil, abrite le plus grand consulat général de Turquie dans le monde, à en croire l’entretien accordé le 29 octobre par le consul général turc à la chaîne d’infos kurde Rûdaw. Le projet très ambitieux de construction d'une ligne de chemin de fer reliant Bassorah, Bagdad et Mossoul au port turc de Mersin nécessite pour sa réalisation une bonne entente avec Bagdad. La fin de l’irrédentisme arabe sunnite via les insurrections d’al-Qaïda et de Daech et celle annoncée de la guérilla du PKK dont les bases arrière se trouvent dans la zone frontalière irako-turque réduisent considérablement les risques d’insécurité sur les grands axes du commerce entre la Turquie et l’Irak qui traversent tous le Kurdistan.
C’est dans ce contexte relativement apaisé que le ministre des Affaires étrangères irakien, Dr. Fuad Hussein, a, lors de sa visite à Ankara le 10 octobre, engagé des pourparlers sur un partage plus équitable des eaux du Tigre et de l’Euphrate entre les deux pays. Selon le Memorandum of Understanding (protocole d’accord) convenu au terme de cette visite, la Turquie va relâcher une certaine quantité d’eau du Tigre et de l’Euphrate à destination de l’Irak pendant 50 jours, c’est-à-dire jusqu’au début de l’hiver et les chutes espérées des pluies et de la neige. Un accord sur le long terme porte sur la gestion des ressources hydrauliques avec l’aide des compagnies turques qui ont une certaine expertise dans ce domaine. L’accord couvre des domaines allant de la construction des barrages en Irak, au recyclage des eaux usées, à la collecte des eaux de pluie et à la désalinisation de l’eau de mer. Cet accord « stratégique » devrait être signé début novembre lors de la visite à Bagdad du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.
Grâce à une meilleure gestion de ses ressources, le Kurdistan irakien n’a jusqu’ici pas trop souffert de la pénurie d’eau, cela malgré la baisse importante du niveau d’eau dans ses barrages (Rudaw, 22 octobre).
L’avenir de ces projets dépendra en grande partie des élections parlementaires du 18 novembre qui, à en croire le président du Kurdistan Nechirvan Barzani, seront les plus importantes depuis celles de 2005. La campagne électorale se déroule dans le calme. Le Premier ministre al-Sudani distribue généreusement prébendes et subsides afin d’assurer à sa coalition chiite la première place au sein de l’électorat chiite. Les Arabes sunnites semblent cette fois-ci plus mobilisés que lors des précédents scrutins pour envoyer un maximum d’élus au Parlement fédéral. Leurs deux principaux partis, soutenus par la puissance financière des pays du Golfe, dépensent sans compter pour séduire les électeurs.
Au Kurdistan, outre les deux partis historiques, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), deux formations islamiques (Yekgirtû et Komal), Nouvelle Génération, Halwast, issu du Parti Goran (Changement), Bereyi Gel (Front du peuple), Parti social-démocrate sont en lice.
Le PDK se fixe comme objectif d’obtenir plus d’un million de voix, contre environ 781.670 aux élections précédentes. La campagne électorale mobilise sans passionner les électeurs – échaudés par les promesses non tenues par les gouvernements fédéraux successifs ne respectant ni la Constitution ni les accords de coalition.
La « fatigue démocratique » est plus grande encore dans l’Irak arabe où la population critique l’état médiocre des infrastructures, la pénurie d’électricité et d’eau, la corruption endémique et le népotisme, le manque de renouvellement de la classe politique et sa dépendance du régime iranien. Le pays paie 6 milliards de dollars par mois de salaires des fonctionnaires et de soldes à des milliers de membres de milices pro-iraniennes Hashd al-Chaabi dont les Américains exigent le désarmement et la dissolution, et la formation d’une armée de métier, bien entraînée, bien équipée, capable de défendre les frontières du pays.
Le régime iranien, qui a perdu ses relais régionaux et son allié stratégique en Syrie, déploie tous ses moyens pour garder sa tutelle sur Bagdad, et finance abondamment les partis chiites qui lui sont proches.
En Irak, il n’existe pas encore de loi sur le financement des partis politiques, ni sur celui des campagnes électorales ni sur celui des financements des médias. Dans cette compétition, malgré la liberté de parole et d’opinion, les candidats indépendants et des partis dépourvus de moyens n’ont guère de chances de se faire connaître et encore moins de se faire élire.
L'actualité iranienne du mois d'octobre a été dominée par la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de mariage à l'occidentale d'un haut dignitaire de la République islamique.
La mariée, Fatima Shamkani, y apparaît en robe décolletée, au bras de son père, Ali Shamkani, ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale et officiant toujours comme haut conseiller du Guide Suprême l'ayatollah Ali Khamenei. Une séquence a été diffusée le 17 octobre montrant Fatima Shamkani vêtue d'une robe blanche de mariée, sans bretelles, décolletée, avec un voile transparent au bras de son père ainsi que sa mère portant une robe bleue décolletée.
De nombreuses invitées assistant à ce mariage se déroulant dans un hôtel de luxe de Téhéran, visibles à l'écran, ne portent pas de hijab, cela dans une République islamique rigoriste où la jeune étudiante kurde Jina Mahsa Amini est morte dans un commissariat de police pour un hijab ne couvrant pas suffisamment ses cheveux. Le mariage aurait eu lieu en avril 2024 mais sa fuite sur les réseaux sociaux est intervenue au lendemain de l'annonce par le secrétaire de la promotion de la vertu et de la répression du vice, Ronhollah Momen-Nasab, de la mobilisation prochaine de 80.000 nouveaux agents de la police des mœurs pour faire respecter le code vestimentaire islamique !
La fuite de la vidéo largement relayée par la chaîne anglo-iranienne Iran International et les milieux de l'opposition est attribuée aux services de renseignement israéliens. Le principal intéressé, Ali Shamkani, a d'ailleurs réagi en postant sur X un message en hébreu : « Bande de salauds, je suis toujours en vie ».
Il avait échappé de justesse à une frappe israélienne lors de la guerre de 12 jours et le voilà empêtré et discrédité dans ce qui en Iran est considéré comme une affaire de mœurs ! Pour la population iranienne il s'agit d'un double scandale : scandale politique pour un régime qui impose à ses citoyens un code vestimentaire moyenâgeux tandis que ses hauts dirigeants prennent leurs libertés et vivent à l'occidentale dans leurs villas et que leurs enfants étudient dans les universités occidentales.
Scandale social aussi où, en raison d'une inflation galopante et de la dévaluation dramatique de la monnaie locale, la grande majorité de la population est condamnée à la pauvreté ; les dirigeants dépensent sans compter pour marier leurs progénitures, dans des hôtels de luxe. La République islamique qui se targuait d'avoir pris la revanche des déshérités sur les élites occidentalisées et corrompues de la monarchie se révèle à son tour hypocrite, corrompue et de plus en plus détachée des préoccupations et des aspirations de sa population. Le régime a réagi par la du président du Conseil d'information du gouvernement, Elias Hazrati : « Il faut être vigilant car l'objectif principal de cette guerre médiatique est de créer de la méfiance et du désespoir dans la société et non de critiquer le comportement des individus ». (Le Figaro, 23 octobre – The New York Times, 20 octobre)
Sur le front nucléaire, après le rétablissement, le 28 septembre, des sanctions internationales par le Conseil de sécurité de l’ONU, l'Iran affirme, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abbas Aragchi, que la coopération avec l'Agence Internationale à l'énergie atomique (AIEA) « n'est plus pertinente » (Le Figaro, 5 octobre). Le même ministre a, le 12 octobre, déclaré que « l'Iran ne voit aucune raison » de reprendre les négociations avec les Européens sur son programme nucléaire alors que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont affirmé le 10 octobre leur « détermination » à les relancer (Le Figaro, 12 octobre). Le 18 octobre l'Iran a fait savoir qu'il n’était plus tenu par « les restrictions » liées à son programme nucléaire, après l’expiration de l'accord signé en 2015 pour dix ans (Le Monde, 18 octobre). L'Iran, qui n'avait déjà pas respecté les clauses de cet accord sur l'enrichissement de l'uranium, va désormais avoir les mains libres pour accélérer davantage son programme nucléaire visant à fabriquer une ou plusieurs bombes atomiques. L’Iran annonçait d’ailleurs par la voix de son Guide suprême que ses sites nucléaires sont encore opérationnels. L'ayatollah Khamenei a déclaré le 20 octobre que le président américain Donald Trump « rêve » s'il pense avoir détruit les sites nucléaires iraniens.
Adoptant un ton volontairement bravache sur le dossier nucléaire, l’Iran cherche néanmoins en coulisse à améliorer ses relations avec certains pays européens dont la France en réactivant sa « diplomatie des otages ». Le 6 octobre, le cycliste globe-trotter franco-allemand Lennart Monterlos, 19 ans, a été libéré après près de quatre mois de détention. (Le Monde, 6 octobre).
Le 16 octobre, les otages français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été condamnés pour « espionnage » à respectivement 20 ans et 17 ans de prison. Ils pourraient cependant être libérés en échange de la libération de la militante iranienne Mahdieh Esfandiari, détenue en France depuis sept mois pour « apologie de terrorisme ». Elle a été libérée le 22 octobre et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français jusqu'à son procès prévu en janvier 2026 (Le Monde, 22 octobre). Ce geste de la justice française devrait déclencher le processus de libération conditionnelle des otages français dans les semaines à venir.
Pendant ce temps, la répression contre les opposants et dissidents supposés se poursuit de manière devenue routinière.
L'ONG kurde des droits de l'homme Hengaw a recensé, en octobre, 8 exécutions de femmes et deux condamnations à mort. Il s'agit de Zeinab Khodabandeh, exécutée à Ispahan, Nahid Hemmati, exécutée à Nahavand, Kafieh Ghobadzadeh, exécutée à Shiraz, Saleheh Khodabadi, exécutée à Ispahan, Narges Ahmadi, exécutée à Qom, Mahbubeh Jalali, exécutée à Rasht, Mitra Zamani, exécutée à Khorramabad et Katayoun Shamsi, exécutée à Mashhad.
Les deux femmes condamnées à mort en octobre sont : Nassim Eslanzchi, militante baloutche, et Zahra Shahbazi Taberi, militante gilaki de Rasht.
Deux militantes kurdes de Turquie, Rojda Saadoun et Safiye Dursun (Curso), ont été condamnées chacune à 5 ans de prison et trois femmes iraniennes Forough Khosravi, Nahid Behrouzi (Karaj) et Elham Salehi (Shiraz) ont été respectivement condamnées à des peines de 15 ans, 5 ans et 1 an de prison.
19 femmes ont été arrêtées sans motif connu. Toujours selon Hengaw, neuf femmes ont été assassinées en octobre par leurs proches pour des « crimes d'honneur », demandes de divorce, refus de mariage ou autres violences domestiques.
L'ONG qualifie la République islamique de « régime d'apartheid de genre » où la violence systématique contre les femmes est institutionnalisée et protégée par la loi.
À l'occasion du premier anniversaire de la disparition de Joyce Blau, l’Institut kurde lui a rendu hommage par une exposition de photographies intitulée Les voyages de Joyce Blau au Kurdistan. Cette exposition, inaugurée le 25 octobre dans les salons de l’Institut devant un public nombreux, présente une sélection de photographies prises par Joyce Blau au cours de ses voyages dans toutes les régions du Kurdistan de 1967 jusqu’au milieu des années 1990.
Le 30 octobre, c’est à Erbil, capitale du Kurdistan, que la première pierre d’un complexe éducatif portant le nom de Joyce Blau a été posée au cours d’une cérémonie émouvante réunissant, outre le président de l’Institut kurde, le gouverneur d’Erbil, le ministre des municipalités et de nombreuses personnalités kurdes. Le complexe éducatif Joyce Blau est situé au cœur du Quartier Français en cours de construction dans la banlieue d’Erbil, pas loin du Lycée Danielle Mitterrand. Le Kurdistan veut ainsi honorer la mémoire de cette universitaire qui, par ses publications et par son activité au sein de l’Institut kurde, a apporté une contribution importante à la cause kurde et aux études kurdes.
Dans l’après-midi du même jour, un hommage a été rendu au Dr Najmaldin Karim, neurochirurgien, vice-président de l’Institut kurde et ancien gouverneur de Kirkouk, à l’occasion du 5e anniversaire de sa mort. La réunion s’est tenue au Palais des Congrès d’Erbil, en présence de la famille et de plusieurs centaines d’amis et proches. Outre Kendal Nezan, le ministre irakien des Affaires étrangères Dr Fuad Hussein, le vice-Premier ministre du Kurdistan Qubad Talabani, le secrétaire du Bureau politique du PDK Fazil Mirani et l’ex-ambassadeur américain Peter Galbraith ont pris la parole pour évoquer la mémoire de ce grand patriote kurde mort en 2020 à l’âge de 70 ans. Des extraits de cette cérémonie d’hommage ont été diffusés sur les chaînes de télévision locales.